"Si
François Ier, en jetant les fondements de son Collège des
trois langues, s'était proposé d'indemniser la France de sa
rançon de Pavie, ce noble but serait atteint depuis longtemps. Le
domaine de la science est en effet naturellement fécond ; ses riches
produits rémunèrent toujours la main bienveillante qui le cultive, et
leur variété même semble ajouter à leur prix.
Toutes les sciences
ont trouvé dans le collège de François 1er un asile honorable, et la
liste de celles qui, jusqu'ici, y furent appelées, formerait une sorte
de résumé encyclopédique des créations de l'intelligence humaine ; on
pourrait ajouter, et un résumé de ses variations et de ses
progrès, car les quatre chaires primitives de 1530 s'élèvent aujourd'hui
à vingt-quatre, et trois seulement des créations fondamentales survivent
intactes à leurs trois siècles d'existence.
Rendons grace,
Messieurs, à cette heureuse instabilité des choses humaines de cet ordre
; le pouvoir de l'intelligence comme sa dignité s'y révèlent, à la fois,
et par des progrès, et surtout par de légitimes exigences ; heureux les
princes qui les ont devinées et satisfaites
Guillaume Budé
avertissait le fondateur du Collège de France, que l'étude des langues,
semblable à une pauvre fille sans dot, était l'objet
d'un
dédain qu'elle n'avait pas mérité ; il réclamait en sa faveur
quelques marques de la protection royale : honorée aujourd'hui à l'égal
de toutes les sciences utiles, cette étude a porté ses fruits. Elle
donne à notre littérature nationale une intelligence plus intime de ses
anciens modèles, et lui en découvre chaque jour de nouveaux ; on lui
doit encore de puissants moyens d'épreuve sur la véracité de l'histoire,
et les fondements de la critique, science qui soumet à son examen les
écrits et les monuments des peuples.
L'Europe savante l'a
reconnu, c'est la France qui eut l'avantage de fournir aux autres
nations et les préceptes et les meilleures applications de la critique
historique. Des noms justement honorés protégèrent les premiers
pas de la science quand elle tenta de s'échapper enfin des langes d'une
routine trop longtemps empirique, et la maintiennent encore dans
sa véritable direction par l'autorité de leur exemple et par l'éclat de
leur renommée. Il faut l'espérer : notre patrie saura conserver ce
précieux héritage, en songeant à l'améliorer plutôt qu'à l'étendre ! Eh
! que pourrait-elle d'ailleurs y ajouter encore, quand, dépassant les
limites mêmes de l'antiquité classique, et poursuivant sa marche, la critique historique embrasse déja dans son domaine les parties les
plus éloignées des continents de l'Asie et de l'Afrique ? C'est sur une
portion de cette vieille terre, qu'une grace récente du roi m'impose
l'honorable devoir de ramener votre attention. La gloire de l'Égypte est
bien ancienne, notre valeureuse France a su la rajeunir en l'associant à
ses propres triomphes : l'Égypte sera donc, à plus d'un titre, un
sujet presque tout français.
Mais ce n'est point de
notre temps seulement que l'Égypte est devenue un objet de recherches
pour l'érudition moderne.
A l'époque de la
Renaissance, l'Europe, si longtemps malheureuse par la violence des
gouvernants et par la profonde ignorance des populations, s'efforçât, en
étudiant avec constance les écrits et les monuments de l'antiquité
échappés aux barbares de races et de religions diverses, de s'approprier
les idées, les sciences, les arts et les formes de civilisation des
peuples qui brillèrent sur la terre avant l'invasion des hordes
scythiques ; et si les nations modernes peuvent s'enorgueillir à bon
droit de leurs lumières ou de leur bien-être matériel, on ne devra point
l'oublier, c'est aux obscurs et longs travaux des lettrés, infatigables
investigateurs des ruines du temps passé, que les sociétés européennes
doivent la possession d'un précieux héritage, les leçons de l'expérience
des peuples nos devanciers, la connaissance des principes fondamentaux
des sciences, des arts et de l'industrie, que nous avons approfondis et
développés d'une manière si merveilleuse.
L'histoire, dont le
but marqué, le seul digne d'elle, est de présenter un tableau véridique
des associations humaines qui marchèrent avant nous dans la carrière de
la civilisation, embrasse une telle immensité de faits d'un ordre si
différent et d'une nature si variée, qu'elle emprunte forcément le
secours de tous les genres d'études, de celles même qui forment, en
apparence du moins, des sciences tout à fait distinctes.
A leur tête se place
la philologie prise dans un sens général, la philologie qui,
procédant d'abord matériellement, fixe la valeur des mots et des
caractères qui les représentent, et étudie le mécanisme des langues
antiques.
Bientôt, s'élevant
dans sa marche, cette science constate les rapports ou les différences
du langage d'un peuple avec les idiomes de ses voisins, compare les
mots, reconnaît les principes qui président à leurs combinaisons dans
chaque famille de langues ou dans chaque langue en particulier, et nous
conduisant ainsi à l'intelligence complète des monuments écrits des vieilles nations, nous initie dans le secret de leurs idées
sociales, de leurs opinions religieuses ou philosophiques ; constate,
énumère les événements survenus pendant leur existence politique, les
retrouve, pour ainsi dire, avec la couleur locale et la nuance du
moment, puisque ce sont en effet les anciens hommes qui nous parlent
alors d'eux-mêmes, directement et sans intermédiaires, au moyen des
signes tracés jadis par leurs propres mains.
Une seconde science,
placée par la nature même de son objet dans des rapports intimes avec la
philologie, ou qui, pour mieux dire, en est inséparable, l'archéologie, assure
à l'histoire ses fondements les plus certains,
en recueillant pour elle les témoignages les plus authentiques de la
réalité des événements passés, les témoignages des monuments originaux,
produits des arts, retracent les faits contemporains dont ils furent
jadis des signes publics, des commémorations consacrées, et qui en
restent pour nous des témoins irrécusables.
C'est principalement
au domaine de ces deux sciences réunies, l'archéologie et la philologie,
indispensables auxiliaires de l'histoire, qu'appartiennent, par leur
propre essence, si l'on peut s'exprimer ainsi, les monuments de
la vieille Égypte, objet principal du cours qui s'ouvre aujourd'hui.
Les innombrables
produits des arts égyptiens, arrivés jusqu'à nous à travers les injures
du temps et malgré les ravages de la barbarie rnusulmane ou de
l'ignorance des premiers chrétiens, sont tous, en effet, à très peu
d'exceptions près, accompagnés d'inscriptions plus ou moins étendues,
relatives à leur destination, et précisant, soit le motif, soit l'époque
de leur exécution. Cette circonstance, heureuse sous tant de rapports,
divise donc naturellement les études archéologiques égyptiennes en deux
branches distinctes ; d'abord, les études philologiques, ayant
pour objet la langue, les divers systèmes d'écriture usités dans
l'antique Égypte, enfin l'interprétation raisonnée et surtout
raisonnable des inscriptions monumentales ; en second lieu, les études
archéologiques proprement dites, embrassant toute la série des
monuments figurés, sous le double rapport de l'art et de leur
destination pour les usages civils ou religieux, militaires ou
domestiques.
La science
archéologique a suivi, depuis sa naissance en Europe, une marche toute
naturelle, en remontant progressivement dans ses recherches la chaîne
chronologique des peuples qui se sont succédé dans la carrière sociale.
L'attention des antiquaires se concentra d'abord sur les monuments des
Romains, monuments épars sur notre sol, les plus voisins de nous, et
servant tour à tour de confirmations positives ou d'utiles
éclaircissements aux textes des auteurs classiques latins, premier objet
des études philologiques en Occident.
En constatant la
liaison des faits pour remonter à l'origine des procédés et du principe
des arts romains, on arriva par des transitions insensibles à la
recherche et à l'étude des monuments de l'ancienne Grèce, d'où étaient
venus les sciences et les arts, qui, adoucissant l'âpreté des mœurs
latines, assurèrent au nom romain, sur les nations de l'ancienne Europe,
cette longue suprématie que n'eussent pu perpétuer les vertus guerrières
et le seul emploi de la force physique.
Dès ce moment,
l'archéologie reconnut que Rome avait reçu par transmission immédiate
les arts de la Grèce, encore empreints de leur simplicité si élégante et
de cette inimitable pureté, principe de toute perfection ; que les
dominateurs du monde, laissant aux Grecs le soin d'embellir la ville
éternelle par les merveilles de l'architecture et de la sculpture,
abandonnèrent leur religion et leur culte même au génie hellénique,
puisque les images des dieux de Rome adorées dans les temples furent des
produits de l'art et du travail de ces étrangers. Mais une telle
concession de la part d'un peuple si jaloux de sa nationalité, trouva
bientôt, aux yeux de l'archéologue, une explication suffisante dans la
communauté d'origine des Grecs et des Romains, issus d'une même race,
comme le prouvent l'extrême analogie de leur langage et l'identité de
leurs croyances religieuses, dissemblables, il est vrai, en quelques
points, quant à la nomenclature, mais parfaitement identiques dans le
fond de la doctrine et dans l'ensemble de leurs formes extérieures.
Ainsi, remontant le
cours des âges, la science archéologique, parvenue à la source
originelle des arts et de la civilisation des Romains, concentra ses
moyens et ses efforts sut l'étude des monuments de l'antique
Grèce, contrée fameuse, considérée, en général et par l'effet inévitable
de l'instruction première donnée aux générations qui se succèdent en Europe depuis plusieurs siècles, comme le berceau primitif de notre
civilisation, comme la véritable terre natale des sciences et des arts.
Mais cette opinion
s'affaiblit et se modifie singulièrement par un examen consciencieux des
traditions et des monuments helléniques : une étude sérieuse, dégagée du
préjugé vulgaire qui, malgré l'évidence des faits et le témoignage
positif des anciens Grecs eux-mêmes, tendrait à faire admettre le
système de la génération spontanée des arts, des sciences et de toutes
les institutions sociales sur le sol de l'ancienne Grèce, nous démontre
que, comme partout ailleurs peut-être, ce pays, habité d'abord par
quelques hordes barbares, fut successivement occupé aussi par des
populations étrangères dont l'arrivée opéra de grands changements et
d'importantes modifications dans la langue comme dans la religion, les
pratiques des arts et les habitudes de la vie civile.
La population
véritablement hellénique est descendue du Nord, et la civilisation lui
vint ensuite du Midi, importée par des étrangers que des circonstances
politiques expulsaient des contrées orientales de l'ancien monde. C'est
là le résumé des documents historiques transmis par les Grecs eux-mêmes
sur leurs temps primitifs : C'est donc dans l'Orient qu'il faut
chercher les origines helléniques ; et l'archéologie, pénétrée de
cette vérité, proclame d'abord la sublime perfection et l'incomparable
supériorité des arts de la Grèce antique. Mais voulant aussi connaître
le véritable point de départ et toutes les transmigrations des arts
et des sciences, elle porte déjà ses regards sur les monuments primitifs
des nations orientales occupant la scène de l'ancien monde, et ayant
opéré de grandes choses avant que, le premier, le nom des Hellènes
sortît brillant de gloire de la profonde obscurité qui, pendant tant de siècles, enveloppa, sans exception, tous les peuples de
l'Occident.
On voit ainsi
s'étendre nécessairement le domaine de l'archéologie ; cette science,
par suite de longs travaux, est parvenue au point où un dernier effort
complétant la connaissance des faits embrassés par ses limites, elle
pourra déduire avec sûreté toutes les conséquences de ces mêmes faits
bien présentés, et fonder enfin un corps de doctrine sur l'origine ou la
transmission des idées sociales et les variations du principe des arts,
signes permanents et si expressifs de l'avancement ou de la décadence
des peuples.
Les historiens
affirment que les introducteurs des premières formes de civilisation, un
peu avancées, parmi les peuplades helléniques de l'Argolide et de
l'Attique, furent des hommes venus par mer des rivages de l'Égypte ;
que, dès ce moment, l'Égypte devint une école où allèrent s instruire
les législateurs de la Grèce, les réformateurs de son culte, et surtout
les Hellènes d'Europe ou d'Asie, qui hâtèrent le développement de la
société grecque, en propageant d'abord, par leur exemple, l'étude des
sciences, de l'histoire et de la philosophie. C'est donc par une
connaissance approfondie des monuments de l'Égypte, en constatant
surtout, par l'évidence des faits, l'antiquité de la civilisation
sur les bords du Nil, antérieurement même à l'existence politique des
Grecs, et de plus les relations nombreuses de la Grèce naissante avec
l'Égypte déja vieille, que l'on remontera à l'origine des arts de la
Grèce, à la source d'une grande partie de ses croyances religieuses et
des formes extérieures de son culte.
L'archéologie s'est
depuis longtemps pénétrée de l'importance de tels résultats ; mais deux
causes principales retardèrent indéfiniment les progrès des études
égyptiennes : la rareté des monuments originaux, et l'ignorance complète
de la langue des anciens Egyptiens.
Dès le XVIIIe siècle
quelques cabinets renfermaient déja un certain nombre d'objets d'art
égyptiens de différents genres, envoyés en Europe par des agents
consulaires, comme de simples objets de curiosité. La plupart de ces
monuments provenaient de fouilles exécutées sur l'emplacement de Memphis
; c'étaient des amulettes, un petit nombre de bronzes, beaucoup de
petites figurines en terre émaillée, images funéraires sorties en
abondance des hypogées de Sakkara ; enfin quelques momies communes et
fort peu remarquables sous le rapport de la décoration ou de la richesse
des peintures. Plus tard on posséda des lambeaux de manuscrits égyptiens
sur toile, des bandelettes couvertes de caractères sacrés, et des
cercueils de momie en pierre dure, chargés de Iongues inscriptions
hiéroglyphiques.
Ces divers objets
appelèrent enfin l'attention des savants sur le système d'écriture des
anciens Egyptiens. Les rares documents épars dans les auteurs grecs et
latins, relatifs à la nature des signes graphiques employés par cette
nation, excitaient encore plus la curiosité. On commença dès cette,
époque à rechercher les monuments figurés de l'Egypte ; on étudia
les obélisques de Rome, récemment exhumés ou relevés par la munificence
des pontifes, et l'archéologie s'enrichit ainsi d'une nouvelle branche,
qui, toutefois, demeura longtemps stérile par la fausse direction que
les érudits imprimèrent à leurs recherches.
Une critique
rigoureusement épurée ne présidait point encore à l'étude des
textes classiques sous le double rapport de l'histoire et de
l'archéologie. On ne saisit point alors les importantes distinctions
formellement établies par les auteurs anciens entre les différents
systèmes d'écritures usités chez les Egyptiens. On généralisa trop ce
que ces auteurs n'avaient affirmé que d'une certaine classe de signes
seulement ; et dès lors les études égyptiennes dévièrent de plus en plus
du but véritable, car, partant de faux aperçus, on mettait en fait que
l'écriture égyptienne, dite hiéroglyphique, ne représentait nullement
le son des mots de la langue parlée ; que tout caractère
hiéroglyphique était le signe particulier dune idée distincte ; enfin, que cette écriture ne procédait à la représentation des idées que
par des symboles et des emblèmes.
De tels principes,
auxquels des érudits de nos jours n'ont point encore renoncé, ouvraient
à l'imagination un champ bien vaste, ou plutôt une carrière sans
limites. le jésuite Kircher s'y jeta, et, ne gardant aucune
réserve, abusa de la bonne foi de ses contemporains, en publiant, sous
le titre d'Oedipus Aegyptiacus, de prétendues traductions des
légendes hiéroglyphiques sculptées sur les obélisques de Rome,
traductions auxquelles il ne croyait point lui-même, car souvent il osa
les étayer sur des citations d'auteurs qui n'existèrent jamais. Du
reste, ni l'archéologie, ni l'histoire ne pouvait recueillir aucun fruit
des travaux de Kircher. Qu'attendre, en effet, d'un homme
affichant la prétention de déchiffrer les textes hiéroglyphiques a priori, sans aucune espèce de méthode ni de preuves ! d'un interprète
qui présentait comme la teneur fidèle d'inscriptions égyptiennes, des
phrases incohérentes remplies du mysticisme à la fois le plus obscur et
le plus ridicule !
Les rêveries de
Kircher contribuèrent aussi à
répandre dans le monde savant ce singulier préjugé, subsistant
aujourd'hui même dans quelques esprits, d'après lequel les inscriptions
hiéroglyphiques sculptées sur tous les monuments, sans exception,
étaient jadis comprises par ceux là seuls d'entre les Egyptiens que
leurs lumières avaient appelés aux grades avancés de l'initiation
religieuse. On croyait alors que tous ces textes antiques roulaient
uniquement sur des sujets cachés et mystérieux ; qu'ils étaient un objet
d'étude réservé à une petite caste privilégiée, et qu'ils renfermaient
uniquement les doctrines occultes de la philosophie égyptienne. Cette
idée fausse parut en quelque sorte confirmée par l'opinion, tout aussi
hasardée, qui attribuait alors à la masse entière des signes composant
l'écriture sacrée des Egyptiens, une nature purement idéographique.
On en était venu à considérer toute inscription égyptienne comme une
série de symboles et d'emblèmes, sous lesquels se cachaient obscurément
de profonds mystères, en un mot, comme la doctrine sacerdotale la plus
secrète expliquée par des énigmes.
Partant de pareilles
hypothèses, les études égyptiennes ne pouvaient compter sur aucun
progrès réel, puisque, d'autre part, on voulait parvenir à
l'intelligence des inscriptions hiéroglyphiques en négligeant
précisément le seul moyen efficace auquel pût se rattacher quelque
espoir de succès : la connaissance préalable de la langue parlée des
anciens Egyptiens. Cette notion était cependant le seul guide que
l'explorateur dût adopter avec confiance, dans les trois hypothèses
possibles sur la nature de cet antique système graphique.
Si, en effet,
l'écriture hiéroglyphique ne se composait que de signes purement idéographiques,
c'est-à-dire de caractères n'ayant aucun rapport
direct avec les sons des mots de la langue parlée, mais
représentant chacun une idée distincte, la connaissance de la langue
égyptienne parlée devenait indispensable, puisque les caractères
emblèmes ou symboles, employés dans l'écriture à la place des mots de la
langue, devaient être disposés dans le même ordre logique et suivre les
mêmes règles de construction que les mots dont ils tenaient la place ;
car il s'agissait de rappeler à l'esprit, en frappant les yeux par la
peinture, les mêmes combinaisons d'idées qu'on réveillait en lui en
s'adressant aux organes du sens de l'ouïe par la parole.
Si, au contraire, et
en opposition à la croyance si générale à cette époque, le système
hiéroglyphique employait exclusivement des caractères de son, ces signes
ou lettres composant l'écriture égyptienne, sculptés avec tant de
profusion sur les monuments publics, ne devaient reproduire d'habitude
que le son des mots propres à la langue parlée des Egyptiens.
En supposant enfin que
l'écriture hiéroglyphique procédât par le mélange simultané de signes
d'idées et de signes de sons, la connaissance de la langue égyptienne
antique restait encore l'élément nécessaire de toute recherche raisonnée
ayant pour but l'interprétation des textes égyptiens.
On ne songea même pas
à user de cet instrument d'exploration d'un effet si certain ; et
cependant il n'était point douteux, même dès les premières années du
XVIIe siècle, que les manuscrits coptes rapportés d'Égypte par
les missionnaires ou par les voyageurs, ne fussent conçus en langue
égyptienne écrite avec des caractères très lisibles, puisque l'alphabet
copte, c'est-à-dire l'alphabet adopté par les Egyptiens devenus
chrétiens, n'est que l'alphabet grec accru de quelques signes.
Par une singularité
bien digne de remarque, ce fut le P. Kircher lui-même qui donna, en
1643, sous le titre de Lingua aegyptiaca restituta, le texte et
la traduction de manuscrits arabes recueillis en Orient par Pietro della
Valle, et contenant des grammaires de la langue copte ; plus, un
vocabulaire copte-arabe. Dans cet ouvrage, qui, malgré ses innombrables
imperfections, a beaucoup contribué à répandre l'étude de la langue
copte, Kircher ne put se défaire de son charlatanisme habituel :
incapable de tirer aucune sorte de profit réel, pour ses travaux
relatifs aux hiéroglyphes, du recueil étendu de mots égyptiens qu'il
venait de publier, il osa introduire dans ce lexique, et donner comme
coptes, plusieurs mots dont il avait besoin pour appuyer ses
explications imaginaires.
Ainsi, la connaissance
du copte fut d'abord propagée en Europe dans le seul intérêt de la
littérature biblique. Saumaise, le premier, montra l'avantage que la
philologie pouvait retirer des notions renfermées dans les textes
coptes, en expliquant par leur moyen un bon nombre d'anciens mots
égyptiens rappelés dans les écrivains grecs. Plus tard, les travaux de
Wilkins et de Lacroze ayant facilité la connaissance de la langue copte,
l'archéologie, détournée des études égyptiennes par d'inutiles
tentatives, et surtout par les extravagants abus que l'on s'était
permis, y fut enfin ramenée par l'espoir assez fondé, en apparence,
d'expliquer le système religieux de l'ancienne Égypte, et par suite les
monuments de son culte, en réunissant et en classant les passages épars
dans les auteurs grecs et latins, concernant les attributions des
divinités égyptiennes, et en interprétant les noms mêmes de ces
divinités à l'aide des vocabulaires coptes. Ce fut là le véritable but
que se proposa Paul-Ernest Jablonsky, lorsqu'il entreprit l'ouvrage
intitulé : Pantheon, Aegyptiorum, sive de Diis eorurn commentarius.
Toutefois, ce savant,
doué d'une vaste érudition, n'avait point pesé toutes les difficultés de
son entreprise. Il était fort présumable, en effet, que les écrivains
grecs et latins, ne parlant que par occasion de la croyance et du culte
des Egyptiens, devaient seulement donner des notions partielles,
locales, et nécessairement incomplètes, du système religieux de cet
ancien peuple ; et quant à l'interprétation des noms égyptiens de
divinités par la langue copte, pouvait-on se flatter déja que le petit
nombre de textes coptes dépouillés par Jablonsky ou par son maître
Wayssière-Lacroze, renfermât tous les mots radicaux dont se composaient
les noms des dieux et des déesses de l'Égypte ? Était-il enfin
démontré que les Grecs et les Latins, en transcrivant ces noms, ne les
avaient aucunement altérés ? Tout prouve, au contraire, que l'analyse
étymologique de ces noms de divinités ne saurait être raisonnablement
tentée, qu'à la condition préalable de connaître l'orthographe égyptienne
de ces mêmes noms : or, cette connaissance si nécessaire
pouvait résulter de la lecture seule des inscriptions égyptiennes. Ces
textes restaient encore muets à l'époque où écrivait Jablonski ; aussi
sommes-nous obligés de le dire, les éléments phonétiques formant les
noms propres originaux des divinités égyptiennes dans les textes
hiéroglyphiques, n'ont rien de commun avec l'orthographe que leur
attribuait Jablonsky, et ne se prêtent nullement à ses interprétations.
La dernière moitié du
XVIIIe siècle vit se renouveler quelques tentatives du même genre, et
tout aussi infructueuses pour l'explication raisonnée des monuments
figurés de l'Égypte, qui, de temps à autre, arrivaient en Europe par
l'effet des relations commerciales avec le Levant. La science ne fit
aucun pas vers l'intelligence des antiques écritures égyptiennes. La
manie des systèmes a priori franchissant toutes les limites du
possible, détourna encore les bons esprits d'un genre d'études tout à
fait discrédité, soit par l'incertitude de ses moyens, soit par
l'extravagance des résultats qu'on prétendait en déduire. Selon les uns,
toutes les inscriptions égyptiennes étaient relatives à l'astronomie ;
elles De renfermaient, selon d'autres, que des préceptes sur l'ensemble
ou les détails des travaux de la campagne ; chaque divinité égyptienne
représentait une des époques de Tannée agricole ; et dans le temps même
où De Guignes et ses disciples, s'efforçant de prouver la communauté
d'origine des peuples de la Chine et des anciens habitants de l'Égypte,
prétendaient interpréter les inscriptions hiéroglyphiques avec le seul
secours des dictionnaires chinois, un esprit tout aussi excentrique
voulut prouver, par le raisonnement, que les différentes images
d'animaux, de plantes, qu'on appelle hiéroglyphes, ne formèrent jamais
une écriture chez les Egyptiens, et n'étaient que de
simples ornements sans signification quelconque.
Au milieu de telles
dissidences, les véritables amis de l'archéologie se contentèrent de
réunir autant que possible, dans les musées publics et dans les cabinets
particuliers, les divers produits de l'art antique des Egyptiens. Lorsqu
'ils en publiaient des gravures ou des fac-simile, ils se
bornaient à les décrire sous le rapport de leur travail, et si l'on
essayait de distinguer entre elles les différentes divinités (car on le
supposait à cette époque, toute figurine égyptienne représentait un dieu
ou une déesse), ce n'était qu'avec précaution, car la nomenclature
des divinités égyptiennes, tirée des auteurs classiques, était bien
promptement épuisée. On peut, sous ce rapport, citer, comme les
promoteurs des études archéologiques égyptiennes, le P. Montfaucon et le
comte de Caylus, quoique ces études n'aient réellement commencé qu'à la
publication du grand ouvrage de Zoëga sur les Obélisques.
Ce savant Danois,
profondément versé dans la connaissance des classiques
grecs
et possédant bien la langue copte, l'un des objets spéciaux de ses
dernières études, réunit dans un vaste travail sur les obélisques
de Rome les principaux résultats de ses recherches relatives à l'Égypte
ancienne. Conduit par l'examen des inscriptions égyptiennes sculptées
sur ce genre de monuments, à s'occuper de l'écriture hiéroglyphique, il
discuta fort en détail et s'efforça d'accorder entre elles les notions
fournies par les écrivains de l'antiquité sur le système graphique des
Egyptiens. Sans y réussir complètement, il parvint cependant à réduire
la question à ses véritables termes, et, le premier, il soupçonna
vaguement l'existence de l'élément phonétique dans le système de
l'écriture sacrée, mais sans lui donner aucune extension, et le
réduisant à quelques caractères qui procédaient à l'expression des sous
par la même méthode que notre jeu d'écriture appelé rébus.
Jugeant avec sévérité
et en pleine connaissance de cause tous les traités publiés avant lui
sur l'interprétation des inscriptions égyptiennes, Zoëga combattit le
préjugé si répandu de l'emploi mystérieux des hiéroglyphes réservé à un
petit nombre d'adeptes et destiné à l'unique transmission des secrets du
sanctuaire. Le savant archéologue pensait avec raison que cette
écriture, celle des monuments publics, connue et pratiquée par la partie
éclairée de la nation égyptienne, fut employée à la rédaction habituelle
des textes relatifs à toutes les matières, objets spéciaux des sciences
sacrées ou profanes. Il croyait toutefois que l'usage d'une telle
écriture, nécessitant une certaine connaissance du dessin, ne pouvait,
sans de grandes difficultés, s'être introduite dans les masses de la
population : cette restriction supposée disparaît aujourd'hui devant
l'existence bien prouvée de deux méthodes tachygraphiques employées par
les anciens Egyptiens afin de rendre le tracé des caractères
hiéroglyphiques aussi facile que rapide.
Zoëga désespéra pour
son époque de voir la science de l'archéologie arriver à la connaissance
complète du système hiéroglyphique, et il abandonna cette découverte à
la postérité. Ce découragement provenait de ce qu'il n'avait pu
s'éloigner d'une manière absolue du faux point de vue qui montrait comme
caractères purement symboliques la plupart des signes employés par
l'écriture sacrée égyptienne, ce qui lui sembla devoir élever des
difficultés presque insurmontables, car il supposait par cela même que
ces caractères, un peu vagues de leur nature, pouvaient varier de
signification, soit employés isolément, soit mis en opposition, soit
enfin en se combinant plusieurs ensemble.
Toutefois, traçant une
esquisse des travaux à entreprendre pour tenter l'interprétation des
textes hiéroglyphiques, il expliqua le non-succès de ses devanciers par
la circonstance que tous, dit-il, avaient commencé par où l'on devait
naturellement finir. On voulait, en effet, attaquer la difficulté de
front, et expliquer de prime abord des inscriptions dont il fallait,
avant tout, bien reconnaître les éléments les plus simples. Joignant
l'exemple au précepte, Zoëga forma avec soin un tableau de tous les
signes hiéroglyphiques existants sur les obélisques ou les monuments
égyptiens conservés à Rome et dans divers cabinets de l'Europe. Cette
exploration préparatoire, qu'il n'a jamais publiée, eût sans doute
engagé le savant danois à poursuivre ses recherches sur les écritures
égyptiennes, aidé surtout par sa profonde connaissance de la langue
copte ; mais sa mort, trop tôt pour la science, vint mettre un terme à
ses utiles travaux.
La publication de
l'ouvrage de Zoëga sur les obéIisques, précéda immédiatement la
conquête de l'Égypte par une armée française. Cette glorieuse
expédition, unique dans son but à la fois politique et scientifique, car
des commissions savantes marchaient avec l'avant-garde de l'armée, donna
une vive impulsion aux recherches archéologiques relatives à l'état
primordial de l'empire des Pharaons. Des Français, que l'amour de la
science avait jetés au milieu des hasards de cette entreprise militaire,
firent connaître à l'Europe, par des dessins fidèles, l'importance et le
nombre prodigieux des monuments antiques de l'Egypte. Des vues
perspectives, des plans et des coupes offrant l'ensemble et les détails
des temples, des palais ou des tombeaux, furent publiés par les ordres
de l'Empereur Napoléon dans le magnifique recueil intitulé :
Description de l'Egypte. Le monde savant conçut pour la première
fois une juste idée de la civilisation égyptienne, comme de
l'inépuisable richesse des documents historiques contenus dans
d'innombrables sculptures, instructifs ornements de ces constructions si
imposantes. La science sentit alors mieux que jamais le défaut total de
notions positives sur le système graphique des Egyptiens ; toutefois,
l'abondance des textes hiéroglyphiques et des inscriptions monumentales
recueillies en Egypte par le zèle de la Commission française, tout en
motivant ses regrets, assura de bien précieux matériaux pour de
nouvelles recherches sur la nature, les procédés et les diverses
combinaisons des écritures égyptiennes ; disons plus : l'espoir de
pénétrer enfin tous les mystères de ce système graphique s'était
réveillé tout à coup dans le monde savant, à la seule annonce de la
découverte d'un monument bilingue trouvé à Rosette.
Un officier du génie,
attaché à la division de notre armée d'Egypte qui occupait la ville de
Rosette, M. Bouchard, trouva en août 1799, dans des fouilles exécutées à
l'ancien fort, une pierre de granit noir, de l'orme rectangulaire, dont
la face bien polie offrait trois inscriptions en trois caractères
différents. L'inscription supérieure, détruite ou fracturée en grande
partie, est en écriture hiéroglyphique ; le
texte intermédiaire appartient à une écriture égyptienne
cursive, et une inscription en langue et en caractères grecs occupe la troisième et dernière division
de la pierre.
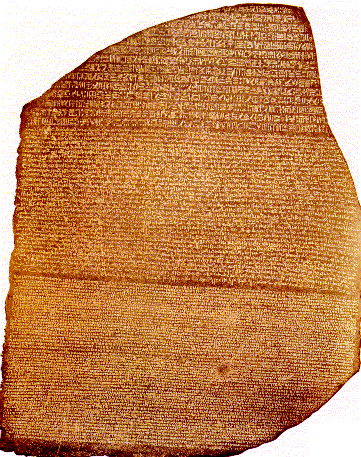
La "pierre de Rosette".
(Elle fait aujourd'hui parti des collections du British Museum
à Londres)
La traduction de ce
dernier texte, contenant un décret du corps sacerdotal de l'Egypte,
réuni à Memphis pour décerner de grands honneurs au roi Ptolémée
Épiphane, donnait la pleine certitude que les deux inscriptions
égyptiennes supérieures contenaient l'expression fidèle du même décret
en langue égyptienne et en deux écritures égyptiennes distinctes, l'écriture sacrée
ou hiéroglyphique, et l'écriture vulgaire ou démotique.
On dut, avec toute
raison, attacher de grandes espérances à la découverte d'un pareil
monument. La possession de textes égyptiens, accompagnés de leur
traduction en une langue connue, venait établir enfin des points de
départ et de comparaison aussi nombreux qu'incontestables, pour conduire
avec sûreté à la connaissance du système graphique égyptien par
l'analyse combinée des deux inscriptions égyptiennes au moyen de
l'inscription grecque. Dès ce moment, il fallut abandonner la voie des
hypothèses pour se circonscrire dans la recherche des faits ; et les
études égyptiennes marchèrent, quoique avec lenteur, vers des résultats
positifs.
Dès 1802, un savant
illustre, auquel nous sommes redevables en France de l'état florissant
de la littérature orientale que ses importants travaux ont si éminemment
contribué à propager dans le reste de l'Europe, M. le baron Silvestre de
Sacy, ayant reçu un fac-simile du monument de Rosette, examina le
texte démotique en le comparant avec le texte grec, et publia le résumé
de ses recherches dans une Lettre adressée à M. le comte Chaptal, alors
ministre de l'intérieur.
Cet écrit renferme les
premières bases du déchiffrement du texte intermédiaire, par la
détermination des groupes de caractères répondant aux noms propres Ptolémée, Arsinoë, Alexandre et Alexandrie,
mentionnés en
différentes occasions dans le texte grec.
Bientôt après, M.
Ackerblad, orientaliste suédois, que distinguaient une érudition très
variée et une connaissance approfondie de la langue copte, suivant la
même route que le savant français, s'engagea à soli exemple dans la
comparaison des deux textes : il publia une analyse des noms propres
grecs cités dans l'inscription en caractères démotiques, et
déduisit en même temps de cette analyse un court alphabet égyptien démotique ou populaire.
Ce premier succès
sembla confirmer d'abord les espérances qu'avait fait naître le monument
de Rosette. Mais Ackerblad, si heureux dans l'analyse des noms propres
grecs, n'obtint aucun résultat en cherchant à appliquer à la lecture des
autres parties de l'inscription démotique, le recueil de signes dont il
venait de constater la valeur dans l'expression écrite de ces noms
propres grecs.
N'ayant point supposé,
d'une part, que les Egyptiens avaient pu écrire les mots de leur langue
en supprimant en grande partie les voyelles médiales, comme cela s'est
pratiqué de tout temps chez les Hébreux et les Arabes ; et d'un
autre côté, ne soupçonnant point que beaucoup de signes employés dans ce
texte pouvaient appartenir à la classe des caractères symboliques, le
savant suédois, rebuté par de vaines tentatives, cessa de
s'occuper du monument de Rosette. Il resta prouvé toutefois, par les
travaux de MM. de Sacy et Ackerbald, que l'écriture vulgaire des anciens
Égyptiens exprimait les noms propres étrangers par le moyen de signes
véritablement alphabétiques.
Quant au texte
hiéroglyphique de la stèle de Rosette, quoiqu'il fat bien naturel de
l'étudier d'abord, puisqu'il se compose de signes-images ou de
caractères figurés, de formes très distinctes, et de le comparer avec le
texte grec pour obtenir quelques notions exactes sur l'essence des
signes sacrés qui forment le plus grand nombre des inscriptions
égyptiennes connues, il ne fat soumis que fort tard à des recherches
consciencieuses et jugées telles par la saine critique. On fut
probablement détourné de s'en occuper par le mauvais état de cette
première portion du monument, des fractures ayant fait disparaître une
grande partie du texte hiéroglyphique. Son intégrité eût épargné, en effet, aux investigateurs, de longs
tâtonnements et
d'innombrables incertitudes.
Cette lacune fut loin
d'être soupçonnée par un anonyme qui, en 1804, publia à Dresde
une prétendue Analyse de l'inscription hiéroglyphique du
monument trouvé à Rosette. L'auteur de cet ouvrage, renouvelant le mystique symbolisme du P. Kircher, crut reconnaître dans les quatorze
lignes encore existantes de l'inscription hiéroglyphique (formant à
peine la moitié de l'inscription primitive), l'expression entière
et suivie des idées exprimées dans les cinquante-quatre lignes du texte
grec. Ce travail ne peut soutenir le plus léger examen ; il vient
néanmoins d'être réimprimé par son auteur, à Florence, comme une sorte
de protestation formelle contre la direction nouvellement donnée aux études sur les hiéroglyphes.
Les auteurs des
nombreux mémoires formant le texte de la Description de
l'Egypte ne s'occupèrent des divers genres d'écritures égyptiennes (lue sous
des rapports purement matériels : ils publièrent des copies d'un grand
nombre d'inscriptions monumentales hiéroglyphiques, aussi fidèlement que
pouvaient alors le permettre et la nouveauté de la matière, et les
dangers sans cesse renaissants autour des courageux explorateurs qui les
avaient recueillies. Ils reconnurent sur les monuments originaux
l'existence de quelques caractères symboliques mentionnés par les
auteurs grecs, mais ne traitèrent que d'une manière générale les
questions relatives à la nature et aux combinaisons des signes
élémentaires - ils s'élevèrent contre l'erreur, alors assez commune, de
confondre sous une même dénomination les figures mises en scène dans les
bas-reliefs avec les véritables hiéroglyphes qui les accompagnent. La Description de l'Égypte
offrit enfin à l'étude des savants d'excellents fac-simile
de manuscrits égyptiens, soit
hiéroglyphiques, soit hiératiques, et donna, toujours trop tard sans
doute, pour l'avancement des études paléographiques, une copie des deux
textes égyptiens du monument de Rosette, beaucoup pins exacte sans
contredit que celle qu'avait déja publiée la Société royale de Londres.
Examiné dans l'intérêt réel de la progression des connaissances
historiques, ce grand ouvrage donna la certitude que les notions les
plus précieuses étaient cachées dans les inscriptions hiéroglyphiques,
ornements obligés de tous les édifices égyptiens ; mais certaines
déductions tirées avant le temps de l'examen des tableaux astronomiques
sculptés au plafond de plusieurs temples, propagèrent de bien graves
erreurs sur l'antiquité relative des monuments. On considéra comme les
plus anciens, en les attribuant aux époques primordiales, des temples
que des faits positifs nous forcent d'attribuer aux époques les plus
récentes ; on supposa même en quelque sorte que tout monument de style
égyptien, décoré d'inscriptions hiéroglyphiques, était par cela même
antérieur à la conquête de l'Égypte par Cambyse - comme si l'Égypte,
qui, sous la domination gréco-romaine, et antérieurement sous le joue,
même des Perses, conserva la plupart de ses institutions
politiques, renonçant tout à coup à sa religion, à ses propres
écritures, avait cessé pendant plus de huit siècles de pratiquer les
arts indispensables à son existence physique et à tous ses besoins
moraux.
En vain les voyageurs
anglais, excités plus peut-être par un esprit de rivalité nationale que
par l'intérêt bien entendu de la science, ont voulu rabaisser
l'importance des travaux exécutés par la Commission française ; son
ouvrage restera toujours comme un digne monument de notre glorieuse
expédition d'Égypte, et les utiles recherches du docteur Young
assureront à l'Angleterre, bien mieux que toutes ces critiques
exagérées, une noble part à l'avancement des études égyptiennes.
Ce savant apporta dans
l'examen comparatif des trois textes du monument de Rosette, un esprit
de méthode éminemment exercé aux plus hautes spéculations des sciences
physiques et mathématiques. Il reconnut par une comparaison toute
matérielle, dans les portions encore existantes de l'inscription démotique
et de l'inscription hiéroglyphique, les groupes de
caractères répondant aux mots employés dans l'inscription grecque. Ce
travail, résultat d'un rapprochement plein de sagacité, établit enfin
quelques notions certaines sur les procédés propres aux diverses
branches du système graphique égyptien et sur leurs liaisons respectives
; il fournit des preuves matérielles à l'assertion des anciens
relativement à l'emploi de caractères figuratifs et symboliques dans l'écriture hiéroglyphique ; mais la nature intime de cette
écriture, ses rapports avec la langue parlée, le nombre, l'essence et
les combinaisons de ses éléments fondamentaux, restèrent encore
incertains dans le vague des hypothèses.
Le docteur Young,
comme les auteurs de la Description de l'Egypte ne sépara
point dune manière assez tranchée l'écriture démotique (celle de la
deuxième partie du monument de Rosette, appelée aussi enchoriale),
de l'écriture cursive employée dans les papyrus non hiéroglyphiques,
textes que j'ai fait reconnaître depuis pour hiératiques, c'est-à-dire appartenant à
une écriture sacerdotale, facile à
distinguer de l'écriture hiéroglyphique par la forme particulière des
signes, et séparée de l'écriture démotique ou populaire par des
différences bien plus essentielles encore.
Quant à la nature des
textes hiératiques et démotiques, le savant anglais embrassa tour à tour
deux systèmes entièrement opposés. En 1816, il croyait, avec la
Commission d'Égypte, à la nature alphabétique de la totalité des
signes composant le texte intermédiaire de Rosette, et il s'efforça, par
le moyen de l'alphabet d'Ackerblad, accru de plusieurs nouveaux signes
auxquels il supposait une valeur fixe, de déterminer la lecture de 80
groupes de caractères démotiques extraits du monument bilingue. Mais en
1819, abandonnant tout à fait l'idée de l'existence réelle de
signes véritablement alphabétiques dans le système graphique égyptien,
le docteur Young affirma, au contraire, que l'écriture démotique
et celle des papyrus hiératiques appartenaient, comme l'écriture
primitive, l'hiéroglyphique, à un système composé de caractères idéographiques purs.
Cependant, convaincu que la plupart
des noms propres mentionnés dans le texte démotique de Rosette sont
susceptibles d'une espèce de lecture avec l'alphabet d'Ackerblad,
il conclut que les Egyptiens, pour transcrire les noms propres
étrangers SEULEMENT, se servirent, comme les Chinois, de signes
réellement idéographiques, mais détournés de leur expression
ordinaire pour leur faire accidentellement représenter des sons.
C'est dans cette persuasion que le savant anglais essaya
d'analyser deux noms propres hiéroglyphiques, celui de Ptolémée et celui de
Bérénice ; mais cette analyse, faussée dans sou
principe, ne conduisit à aucune sorte de résultat, pas même pour
la lecture d'un seul des noms propres sculptés en si grande abondance
sur les monuments de l'Égypte.
La question relative à
la nature élémentaire du 'système hiéroglyphique restait donc tout
entière : les écritures égyptiennes procédaient elles
idéographiquement, ou bien exprimaient-elles les idées en
notant le son même des mots ?
Mes travaux ont
démontré que la vérité se trouvait précisément entre ces deux hypothèses
extrêmes : c'est-à-dire que le système graphique égyptien tout entier
employa simultanément des signes d'idées et des signes de sons
; que les caractères phonétiques, de même nature que les
lettres de notre alphabet, loin de se borner à la seule expression des
noms propres étrangers, formaient au contraire la partie la plus
considérable des textes égyptiens hiéroglyphiques, hiératiques et
démotiques, et y représentaient, en se combinant entre eux, les sons et
les articulations des mots propres à la langue égyptienne parlée.
Ce point de fait
fondamental, démontré et développé pour la première fois en 1824 dans
mon ouvrage intitulé Précis du système hiéroglyphique [Réimprimé en 1828],
étant appliqué à une foule de monuments
originaux, a reçu les confirmations les plus complètes et les moins
attendues. Seize mois entiers passés au milieu des ruines de la
Haute et de la Basse-Égypte, grace à la munificence de notre
gouvernement, n'ont apporté aucune sorte de modification à ce principe,
dont j'ai eu tant et de si importantes occasions d'éprouver la certitude
comme l'admirable fécondité.
Son application seule
a pu me conduire à la lecture proprement dite des portions
phonétiques, formant en réalité les trois quarts au moins de chaque
texte hiéroglyphique : de là est résultée la pleine conviction
que la langue égyptienne antique ne différait en rien d'essentiel de la
langue vulgairement appelée copte ou cophthe ; que les mots
égyptiens écrits en caractères hiéroglyphiques sur les monuments les
plus antiques de Thèbes, et en caractères grecs dans les livres coptes,
ont une valeur identique et ne diffèrent en général que par l'absence de
certaines voyelles médiales, omises, selon la méthode orientale, dans
l'orthographe primitive. Les caractères idéographiques ou symboliques,
entremêlés aux caractères de son, devinrent plus distincts ; je pus
saisir les lois de leurs combinaisons, soit entre eux, soit avec des
signes phonétiques, et j'arrivai successivement à la connaissance de
toutes les formes et notations grammaticales exprimées dans les textes
égyptiens, soit hiéroglyphiques, soit hiératiques.
Ainsi fut levé peu à
peu le voile qui couvrait la nature intime du système graphique
égyptien ; les matériaux immenses que j'ai recueillis pendant mon
séjour en Égypte, et en Nubie entre les deux cataractes, m'ait donné le
moyen de développer ces résultats. Un devoir m'était encore imposé,
celui de les faire connaître dans toute leur étendue au monde savant, de
démontrer leur importance par celle des faits nouveaux qui naissent de
leur application, et d'ouvrir une carrière toute nouvelle au zèle des
esprits investigateurs qui se consacrent à l'avancement des études
historiques. Les bontés du roi, en m'appelant à occuper une chaire
d'archéologie, me donnent l'occasion d'accomplir ce devoir et de
répondre, autant qu'il sera en moi, à ces nouveaux besoins des sciences,
qui, presque toutes, doivent s'enrichir de précieux documents par une
étude régulière et approfondie des antiquités égyptiennes.
C'est, en effet, en
nous initiant de plus en plus dans l'intelligence des textes
hiéroglyphiques et hiératiques, lesquels fixent la date et la
destination des monuments figurés ;
c'est par l'analyse raisonnée de la langue des Pharaons, que
l'ethnographie décidera si la vieille population égyptienne fut
d'origine asiatique ou bien si elle descendit, avec le fleuve divinisé,
des plateaux de l'Afrique centrale.
On décidera en même temps si les
Egyptiens n'appartenaient point à une race distincte ; car, il faut le
déclarer ici, contre l'opinion commune, les Coptes de l'Égypte
moderne, regardés comme les derniers rejetons des anciens Egyptiens,
n'ont offert à mes yeux ni la couleur ni aucun des traits
caractéristiques, dans les linéaments du visage ou dans les formes du
corps, qui pût constater une aussi noble descendance. La connaissance
réelle de l'Égypte ancienne importe également aux études bibliques, et
la critique sacrée doit en retirer, de nombreux éclaircissements. La
longue captivité des Hébreux en Égypte, l'éducation tout égyptienne de
leur premier législateur, durent nécessairement s'empreindre dans
l'organisation politique et religieuse des enfants d'Israël. Les tribus
échappées par la ruse à l'oppression d'un peuple bien plus avancé
qu'elles-mêmes dans la civilisation, ne purent, en rentrant dans
le désert, se dépouiller en même temps des idées d'ordre, des
habitudes civiles, ni oublier les pratiques des arts acquises pendant un
séjour prolongé sur les rives du Nil, au milieu d'une nation agricole.
Le chef hébreu renouvelant la plus ancienne forme du gouvernement
égyptien, la théocratie, qui se prêtait d'une manière plus
efficace à l'accomplissement de ses vues, quitta la vallée de l'Égypte,
non pour ramener les tribus à leur état primitif, à la vie nomade et
pastorale de leurs pères, mais avec le dessein formé de les fixer sur un
territoire limité, acquis par la conquête, et de les constituer, comme
les Égyptiens, en une nation sédentaire, établie dans des villes,
cultivant le sol et s'adonnant à tous les arts industriels. Moïse
appliqua, autant que les circonstances locales devaient le permettre,
les institutions civiles des Egyptiens à l'organisation de la société
hébraïque ; il proclama des dogmes religieux essentiellement distincts
de ceux de l'Égypte - mais dans les formes extérieures du culte, et
surtout dans le matériel dès cérémonies, il dut imiter et il imita en
effet les pratiques égyptiennes. L'étude des monuments égyptiens
originaux, soit antérieurs, soit postérieurs à l'époque de Moïse,
donnera donc une intelligence plus complète des textes originaux de la
Bible.
La renommée et la
richesse du sol de l'Égypte, aussi bien que son importance politique dès
les temps les plus reculés, ont lié l'histoire de cette contrée avec
celle de tous les grands peuples de l'Afrique et de l'Asie anciennes.
Mais les annales de la plupart de ces nations ayant péri sans retour, il
faut interroger les monuments écrits de l'Égypte ils nous rediront les
noms des peuplades, aujourd'hui oubliées, jadis soumises à la puissance
égyptienne par les Pharaons pénétrant dans l'intérieur de l'Afrique, et
appelant les barbares à la civilisation par le contact ou par l'exemple.
Les bas-reliefs d'Isamboul et de Beit-Oually, en Nubie, nous montreront
les traits physiques de ces hommes de race nègre ou de race caffre,
l'époque de leur soumission, leur costume, leur manière de combattre,
les détails même de leur vie domestique, et les rapports directs et
variés de la primitive Égypte avec l'Éthiopie, contrée fameuse où nous
reconnaîtrons peut-être le berceau de la population égyptienne.
Par l'étude des
tableaux historiques sculptés dans les vastes palais de Thèbes, l'aînée
des villes royales, nous assisterons en quelque sorte aux expéditions
militaires exécutées en Asie dans des temps dont les annales des hommes
n'ont conservé qu'un souvenir confus : les noms des rois égyptiens
auteurs de ces grandes entreprises Guerrières, ramenés à la réalité par
le témoignage irrécusable des monuments contemporains, rentreront enfin
dans le domaine positif de l'histoire, et cette science reculant ses
limites, portera des lumières inespérées sur des époques abandonnées
jusqu'ici dans le vague des périodes fabuleuses, à cause du défaut total
de documents, ou de l'incertitude extrême des traditions.
Ces bas-reliefs,
immenses compositions, si remarquables par le grandiose de l'ensemble et
l'incroyable variété des détails, si importants d'ailleurs par les
légendes explicatives qui leur donnent un caractère tout à fait
historique, offriront en même temps à notre curiosité les noms des
peuples asiatiques rivaux de l'Égypte, qui lui disputaient la suprématie
dans cet ancien monde politique encore inconnu, et dont l'histoire
écrite abandonne à regret l'époque tout entière aux fictions des mythes
héroïques. Ils fourniront les notions les plus précises sur les races
d'hommes auxquelles appartenaient ces nations si diversifiées par les
traits de la physionomie, par le costume, par la forme des armes et par
les moyens d'attaque ou de défense. On estimera le degré d'avancement de
chacun de ces peuples dans la civilisation et les commodités de la vie,
d'après les tableaux sculptés ou peints, représentant soit des
ambassades africaines ou asiatiques offrant de nombreux présents au
monarque égyptien leur maître ou leur allié, soit le Pharaon lui-même
qui, triomphant, dépose aux pieds des dieux de l'Égypte les productions
naturelles des pays conquis, les produits de l'industrie et les
richesses des vaincus, enfin les vases d'or et d'argent, admirables de
forme et l'élégance, exécutés avec ces métaux précieux enlevés à
l'ennemi.
On s'instruira bien
mieux encore en étudiant les Iongues inscriptions sculptées sur les
murailles du palais des rois, et contenant le détail circonstancié des
expéditions militaires, le poids des pierreries et des divers métaux
imposés sur l'ennemi, l'énumération des animaux domestiques, celle des
denrées et des objets d'art que les pays conquis devaient régulièrement
livrer au vainqueur. Ces inscriptions monumentales furent expliquées à
Germanicus visitant les ruines de Thèbes, par les plus âgés d'entre les
prêtres du pays ; elles existent encore en grande partie, et Tacite,
racontant le séjour du fils adoptif de Tibère au milieu des débris de la
vieille capitale des Pharaons, a donné du contenu de ces textes
historiques une analyse surprenante par son exactitude : l'historien
romain semble avoir écrit en ayant sous les yeux une traduction
littérale de ces antiques textes ; je les ai retrouvés dans les
décombres du palais de Karnac.
Sur le sol de
l'Égypte, le nombre des monuments de tout genre échappés aux
dévastations des siècles et des religions ennemies, est encore tel,
qu'on peut y recueillir en abondance des témoignages directs de l'état
graduel de la civilisation du peuple industrieux qui défricha la vallée
inférieure du Nil à une époque indéfiniment reculée : car, il faut le
dire, les monuments égyptiens des temps les plus antiques ne montrent
aucune trace de l'enfance de l'art ; tous le manifestent au contraire à
un âge adulte et plein d'expérience. Mais si l'Egypte, dans des périodes
fort antérieures aux temps historiques de notre Occident, vit
disparaître ses premiers essais de sculpture, de peinture, ou
d'architecture, et les remplaça par des produits de ces arts déja
développés, régularisés, et empreints d'un caractère de simplicité
Grandiose qu'on ne saurait trop admirer ; si l'Égypte, disons-nous, ne
conserva aucune trace de ses propres origines, c'est toutefois dans
cette contrée que nous devons chercher les origines de la civilisation
comme des arts de la Grèce, et par suite le point de départ de notre
civilisation moderne.
L'étude des monuments
et des textes égyptiens, en nous présentant sous son véritable jour
l'état politique et religieux du vieil empire des Pharaons, en
constatait d'autre part l'état avancé des arts de l'Égypte bien
antérieurement aux premières productions de ces mêmes arts en Europe,
nous conduira à la source des premières institutions politiques de la
Grèce, à Argos et dans Athènes - cette étude démontrera, par des faits
incontestables, l'origine égyptienne d'une partie très importante des
mythes et des pratiques religieuses des Hellènes, sur lesquels restent
encore tant d'incertitudes, et qu'on n'a su jusqu'ici réduire en un système régulier, parce qu'on néglige en général de séparer ce qui
appartient en propre à la population hellène et ce qu'elle a reçu des
colonies orientales.
On reconnaîtra dans
les portiques de Beni-Hassan, et dans les galeries de Karnac, exécutées
par les Égyptiens bien avant l'époque du siége de Troie, l'origine
évidente de l'architecture dorique des Grecs ; en examinant sans
prévention les bas-reliefs historiques de Nubie et de Thèbes, on se
convaincra que l'art des Grecs eut des sculptures égyptiennes pour
premiers modèles ; que d'abord il les imita servilement, et se pénétra
de la sage simplicité de leur style ; qu'enrichi de ces moyens, l'art
grec, adoptant un principe qui ne fut jamais celui de l'art égyptien, la
reproduction obligée des belles formes de la nature, s'éloigna de plus
en plus du faire primitif, et s'éleva de lui-même à cette sublimité que
n'atteindront peut-être jamais les efforts de nos artistes modernes.
L'interprétation des
monuments de l'Egypte mettra encore mieux en évidence l'origine
égyptienne des sciences et des principales doctrines philosophiques de
la Grèce ; l'école platonicienne n'est que l'égyptianisme, sorti des
sanctuaires de Saïs ; et la vieille secte pythagoricienne propagea des
théories psychologiques qui sont développées dans les peintures et dans
les légendes sacrées des tombeaux des rois de Thèbes, au fond de la
vallée déserte de Biban-el-Molouk.
Mais je dois me borner
à ces indications partielles sur la série des faits nouveaux dont les
études égyptiennes promettent d'enrichir les sciences historiques. On
l'a pressenti sans doute ; d'aussi importants résultats ne sauraient
acquérir leur poids et toute leur certitude que de l'intelligence réelle
des innombrables inscriptions sculptées ou peintes sur les monuments
égyptiens, et l'étude de la langue parlée doit précéder celle des textes
où elle est employée. Ce sera donc par l'exposé approfondi des principes
de la Grammaire égyptienne et des signes qui leur sont propres,
que nous commencerons des leçons d'où leur sujet même doit bannir tout
ornement ; à défaut de cet avantage, qui contribuerait sans doute à nous
concilier et à soutenir votre attention, j'invoquerai, messieurs, le
haut intérêt du sujet de nos études, et la sincérité de mon zèle me fera
peut-être quelques titres à votre indulgence.

