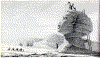 Le Colloque du Caire, 1974
Le Colloque du Caire, 1974
Le
peuplement de l'Egypte ancienne et le déchiffrement de
l'écriture
méroïtique
I. Introduction
Les
travaux de Cheikh Anta DIOP, dès 1954 — il y a 40 ans — avec Nations
nègres et Culture, puis avec L'unité culturelle de l'Afrique
noire et L'Afrique noire précoloniale en 1959-1960,
inaugurent une nouvelle approche de l'histoire de l'humanité. Il s'agit
de rompre avec la vision ahistorique et ethnographique de l'Afrique qui
repose, entre autres, sur des présupposés hégéliens [G. W. F. HEGEL, La Raison dans l'histoire - Introduction à la philosophie de l'histoire]
et gobinistes [J. A. GOBINEAU, Comte de, Essai sur l'inégalité des
races] hérités du XIXe siècle.
C'est une nouvelle "méthodologie en
matière d'histoire africaine" qu'il préconise et met en œuvre dans
ses propres travaux. Il lui consacre le chapitre X de son livre Antériorité des civilisations nègres – Mythe ou vérité historique ?
paru en 1967 aux Éditions Présence Africaine. Parmi les axes de cette
méthodologie on peut retenir :
- l'analyse des "phases d'évolution
politico-sociales" des sociétés,
- "l'ethnonymie et la toponymie",
- l'analyse des "faits linguistiques",
- l'établissement "des corrélations entre
des évènements intérieurs et extérieurs",
- les faits archéologiques :
"Elle
[l'archéologie] introduit la certitude brutale là où il n'y avait que
doute, scepticisme ou supputation. Ses résultats ruinent chaque jour les
dogmes fondés sur les notions peu scientifiques de vraisemblance
historique…".
En outre, ce chapitre dresse un bref
inventaire des méthodes des sciences exactes :
- datations,
- analyses chimiques,
- techniques de détection,
- photographie aérienne, etc.
qui peuvent être mises au service de
l'histoire africaine, comme lui-même s'y employait dans le laboratoire
de datation par le carbone 14 qu'il avait créé à Dakar.
On peut donc affirmer que Cheikh Anta DIOP a
"réinventé" l'histoire africaine en lui donnant une assise temporelle,
une perspective diachronique qui lui faisaient cruellement défaut. Ce
faisant, il a mis en évidence la nécessité d'une réécriture de
l'histoire de l'humanité.
On comprend dès lors que
l'UNESCO l'ait sollicité, en 1970, à devenir membre du Comité
scientifique international pour la rédaction d'une Histoire générale
de l'Afrique.
II. L'Histoire
générale de l'Afrique - Préalables méthodologiques
Son
exigence d'objectivité le conduit à poser trois préalables à la
rédaction des chapitres consacrés à l'histoire ancienne de l'Afrique
[cf. L'Antiquité africaine par l'image, Dakar, IFAN-NEA, Notes
africaines n° 145-146, p. 6]. Les deux premiers consistent en la tenue
d'un colloque international, organisé par l'UNESCO, réunissant des
chercheurs de réputation mondiale, pour d'une part, débattre de
l'origine des anciens Égyptiens, et d'autre part faire le point sur le
déchiffrement de l'écriture méroïtique.
Le projet envisagé par
l'UNESCO rend primordial de traiter la question de savoir à quelle aire
culturelle et à quel univers anthropologique appartient l'Égypte
ancienne compte tenu de l'état des connaissances. Une confrontation des
travaux de spécialistes du monde entier lui apparaît indispensable pour
faire avancer la science historique.
Le troisième préalable
concerne la réalisation d'une couverture aérienne de l'Afrique.
C'est dans ce contexte, que
se tient au Caire du 28 janvier au 3 février 1974, organisé par l'UNESCO
dans le cadre de la Rédaction de l'Histoire générale de l'Afrique,
le colloque intitulé : "Le peuplement de l'Égypte ancienne et le
déchiffrement de l'écriture méroïtique".
III. Les
participants au colloque du Caire
Vingt spécialistes, cinq observateurs et deux représentants de l'UNESCO appartenant à quatorze nations différentes.
Spécialistes
:
- A. M. ABDALLA, Department of History,
University of Khartoum, Soudan
- A. Abu BAKR, Université du Caire, Égypte
- N. BLANC, École Pratique des Hautes
Études, Paris, France
- F. DEBONO, expert UNESCO, Centre de
documentation sur l'Égypte ancienne, Malte
- J. DEVISSE, Université Paris VIII, Paris
- C. A. DIOP, Université de Dakar, Sénégal
- G. GHALLAB, Institute of African Research
and Studies, Université du Caire, Égypte
- L. HABACHI, Oriental Institute, University
of Chicago, États-Unis
- R. HOLTOER, University of Helsinki,
Finlande
- S. HUSAIN, Egyptian Organization of
Antiquities, Le Caire, Égypte
- J. GORDON-JACQUET, c/o Institut français
d'archéologie orientale du Caire, États-Unis
- W. KAISER, German Institute of Archaeology
du Caire, République Fédérale d'Allemagne
- J. LECLANT, Université Paris-Sorbonne,
Paris
- G. MOKHTAR, Direction du Service des
Antiquités, Égypte
- R. EL NADURI, Faculty of Arts, Alexandria,
Égypte,
- T. OBENGA, Professeur Université Mariem N'Gouabi,
Brazzaville, Congo
- S. SAUNERON, Institut français
d'archéologie orientale du Caire, France
- T. SÄVE-SÖDERBERG, Université d'Uppsala,
Suède
- P. L. SHINNIE, Department of Archaeology,
University of Calgary, Canada
- J. VERCOUTTER, Institut de papyrologie et
d'égyptologie de l'Université de Lille
Observateurs
:
- V. L. GROTTANELLI, Institut d'ethnologie,
Université de Rome, Italie
- S. HABLE SELASSIE, Department of History,
Haile Selassie I University, Éthiopie
- F. H. HUSSEIN, Department of Physical
Anthropology, National Research Center, Le Caire, Égypte
- L. KAKOSY, Department of Ancient Oriental
History, Université de Budapest V, Hongrie
- P. A. DIOP, journaliste du quotidien
sénégalais Le Soleil, Dakar, Sénégal
Représentants de l'UNESCO
:
- M. GLÉLÉ, Division des études des cultures
- Mme MELCER, Division des études des
cultures
Les Actes de ce colloque, dont le professeur
Jean DEVISSE est le rapporteur, sont publiés par l'UNESCO dans Le
peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture
méroïtique, Histoire générale de l'Afrique, Études et
documents 1, Paris, UNESCO, 1978. Le lecteur trouvera également un
rapport de synthèse en annexe du Volume II de l'Histoire générale de
l'Afrique, Paris, Jeune Afrique/Stock/UNESCO, 1980, pp. 795-823.
Le journaliste Papa Amet DIOP couvre, pour
le quotidien sénégalais Le Soleil, l'ensemble du colloque (grand
reportage en six parties dans les numéros 1128, 1145, 1146, 1148, 1149,
1151 du Soleil des mois de janvier et février 1974).
On ne fera, ici, que rappeler très
brièvement les principaux thèmes de discussions, les points durs ainsi
que les avancées apparus au fil des divers exposés et discussions, tout
en conviant vivement le lecteur à se reporter aux comptes rendus
sus-mentionnés.
IV.
Le Peuplement de l'Égypte ancienne
(1ère partie du colloque du
28 au 31 janvier 1974)
Les communications
Les
discussions se sont articulées autour de thèmes développés dans les
trois communications écrites.
- Le peuplement de l'Égypte
ancienne, par Jean VERCOUTTER
(cf.
Le
peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture
méroïtique, Histoire générale de l'Afrique, Études et
documents 1, Paris, UNESCO, 1978, pp. 15-36).
Le professeur J. VERCOUTTER recense quatre
types de sources disponibles pour l'étude du peuplement de l'Égypte
ancienne :
. anthropologiques (étude anthropologique
physique des restes humains)
. iconographiques (desseins, peintures,
bas-reliefs, statues)
. linguistiques : "le langage et
l'écriture d'un groupe humain pouvant fournir des renseignements sur
l'origine et la nature ethnique de ce groupe"
. ethnologiques : "grâce à la comparaison
des sources précédentes avec les caractéristiques des groupes ethniques
ou culturels de l'Antiquité".
Il fait un état du matériel anthropologique
mis au jour par les fouilles menées dans la vallée du Nil tout en
mentionnant les lacunes existantes dans le temps et l'espace.
Il s'attache ensuite à présenter les
différentes thèses sur l'origine ethnique des anciens Égyptiens. Deux
thèses s'opposent, considérées comme absolues par l'auteur :
. "… la majorité des égyptologues
(VANDIER, 1952, p. 22) estime que la population primitive qui occupe la
vallée du Nil égyptienne et nubienne, dès le Prédynastique (Badarien et
Amratien ou Nagada I) et jusqu'à la première dynastie, appartient à une
race brune, "méditerranéenne" ou encore "euro-africaine", souvent
improprement appelée "hamite", ou encore "khamite". Cette population
serait leucoderme, donc blanche, même si sa pigmentation est foncée
pouvant aller jusqu'au noir ; […] Ce type [humain] serait donc d'origine
africaine, sans être "nègre" au sens où on l'entend habituellement. Au
demeurant même les égyptologues convaincus du caractère africain
essentiel de la civilisation égyptienne insistent sur le fait que la
population qui a créé cette civilisation n'était pas "nègre" (NAVILLE,
1911, p. 199 ; BISSING, 1929 ; FRANKFORT, 1950]."
. "Sous l'impulsion du Cheikh Anta DIOP,
à l'appartenance caucasoïde (l'expression est de CORNEVIN, 1963, p.
103-104 et 152) de la population de l'Égypte, généralement acceptée
jusqu'en 1955, une appartenance "négroïde" de cette même population a
été substituée (DIOP, 1955, p. 21-253 ; 1959, p. 54-58 ; 1960, p. 13-15
: 1962a, p. 449-541). Ontrouvera dans un récent ouvrage un résumé fidèle
et développé de la thèse de Cheikh Anta DIOP (OBENGA, 1973), qui est
formulée avec vigueur : "en fait, les habitants néolithiques et
prédynastiques de la vallée égyptienne et nubienne étaient des Nègres …
Ce sont des Nègres qui ont bâti les civilisations égypto-nubiennes
préhistoriques … et historiques (OBENGA, 1973, p. 102)."
Il dégage enfin, après avoir exprimé son
propre point de vue sur la question, thèmes de discussion et axes de
recherches portant sur :
. les contacts entre l'Égypte et le reste de
l'Afrique (Libye, Sahara oriental et sud-oriental, Darfour, Soudan
oriental et méridional, Éthiopie actuelle), une telle étude devant être
précédée par des précisions terminologiques des termes "nègre" et
"négroïde",
. la définition des Hamites,
. le réexamen de l'origine du néolithique
égyptien, suscité par les résultats de travaux récents en Basse-Nubie,
au Soudan et en Asie,
. en connexion avec le thème précédent, le
"rôle du Croissant fertile africain dans le peuplement de l'Égypte",
. la région du delta du Nil :
"la lacune
la plus grave dans nos connaissances est celle qui concerne le delta
égyptien. […] La recherche est d'autant plus importante dans ce domaine
que l'on fait souvent du delta le foyer d'origine des populations ayant
porté la civilisation à la Haute-Égypte",
. "la nature et la situation géographique
des différentes ethnies africaines dans l'Antiquité […] … le problème
des pygmées en Égypte qui est lié à celui des rapports ethniques de
l'Égypte et de l'Afrique au sud du Sahara, mériterait d'être approfondi",
. les fouilles dans les régions
périphériques de la vallée du Nil au sud de la seconde cataracte qui
sont zones archéologiques "sous-explorées".
- Le peuplement de la vallée
du Nil au sud du 23e parallèle, par Nicole BLANC
(cf.
Le
peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture
méroïtique, Histoire générale de l'Afrique, Études et
documents 1, Paris, UNESCO, 1978, pp. 37-64).
Elle constate en premier lieu que :
"L'importance d'une histoire du peuplement
de la vallée du Nil sur toute sa longueur, et non plus seulement dans sa
partie égyptienne, n'a été reconnue que ces toutes dernières années. Il
était généralement admis auparavant par la tradition historique
classique que le passé des contrées riveraines du Nil s'était écrit à
contre-courant du fleuve, que celui-ci avait joué le rôle d'une grande
artère de communication, mais uniquement dans le sens inverse du cours
naturel des eaux, conduisant peuples et cultures des rives civilisées de
la Méditerranée aux obscures régions d'Afrique noire, à travers les
zones arides de la Haute-Nubie et les marécages du cours méridional du
Nil blanc."
L'auteur rappelle l'ensemble des travaux de
fouilles effectuées au sud de la seconde cataracte, en particulier ceux
de l'Américain G. A. REISNER , "l'un des fondateurs de l'archéologie
du Soudan", F. GRIFFITH, le déchiffreur de l'écriture méroïtique,
des directeurs successifs du Service des antiquités du Soudan : A. J.
ARKELL, P. L. SHINNIE, J. VERCOUTTER, T. H. THABIT) et indique que "les résultats des fouilles amenèrent les chercheurs à s'interroger sur
la part africaine dans les civilisations riveraines du Nil et à
envisager, sur des bases scientifiques sérieuses, l'existence d'un
contre-courant, de l'Afrique noire à la Méditerranée".
Au plan méthodologique, elle est amenée à
insister sur le fait que les faibles chances de conservation de vestiges
archéologiques en raison de la nature du sol et du climat et le
caractère récent des sources écrites rendent nécessaire le recours à
d'autres sources qu'il est possible d'exploiter dans une perspective
historique : la tradition orale, la linguistique africaine, et enfin
l'anthropologie, les données de l'une pouvant remédier, dans une
approche synthétique, à l'insuffisance des données des autres.
Ces préliminaires d'ordre à la fois
historique et méthodologique étant posés, N. BLANC propose une approche
géographique du thème du colloque qui la conduit à esquisser "les
principales caractéristiques géographiques et écologiques du bassin du
Nil au sud du 23e parallèle jusqu'à la source du fleuve, en Ouganda".
L'une des conclusions qui se dégagent est
que le Nil constitue l'une des plus anciennes voies navigables
intérieures connues. "[…] Certes il n'est pas navigable sur toute la
longueur de son cours, notamment dans sa partie soudanaise".
Cependant "… le relief peu accusé dans l'ensemble du Nord Soudan n'a
nulle part constitué un obstacle sérieux aux mouvements de population, à
la diffusion culturelle, et au commerce …".
Un autre aspect qualifié de très important
par l'auteur, est celui d'une "relative ouverture vers l'extérieur"
de cette partie de la vallée du Nil située entre le 10e et le 23e
parallèle : ouverture d'une part vers l'Afrique occidentale et
subsaharienne et de l'autre vers l'Asie (Sinaï, mer Rouge, golfe
d'Aden).
L'auteur est alors en mesure d'identifier
les grands axes de communications ou "les grandes routes" dont le
réseau s'est tissé au fil de l'histoire et sous la pression géographique
reliant une région de la vallée du Nil à une autre ou bien connectant la
vallée du Nil à des régions périphériques.
C'est dans cette même logique qu'elle aborde
le peuplement de la vallée du Nil, mais en remontant le cours du temps :
la pénétration arabe est d'abord décrite, suivie de l'exposé des
différentes thèses relatives à l'origine des populations présentes au
Nord Soudan avant l'arrivée des Arabes. Cet exposé fait ressortir, qu'à
l'instar de l'Égypte ancienne, l'appartenance anthropologique des
bâtisseurs des civilisations du Soudan fait aussi l'objet d'un débat
entre spécialistes. L'auteur précise cependant que "De toute manière,
et ceci paraît généralement admis aujourd'hui, il faut considérer très
sérieusement l'hypothèse d'une importante contribution de cultures
africaines antérieures à ces civilisations".
Enfin, une dernière section est consacrée au
peuplement de la vallée du Nil au sud du 10e parallèle qui marque une
brusque "rupture" naturelle à l'intérieur de l'actuel Soudan. Les
conditions géoclimatiques apparaissent défavorables à l'existence de
grandes voies de communication et aux activités sédentaires, un mode de
vie pastoral nomade et semi-nomade en petits groupes s'y étant
développé. Les fouilles archéologiques sont inexistantes. L'auteur
rappelle toutefois qu'il existe des travaux de linguistes et
d'anthropologues sur les différents groupes nilotes (Nuer, Dinka,
Shilluk, Anuak, etc.) vivant dans cette région du sud Soudan. Des
hypothèses diverses sont émises quant à leur origine et leurs
déplacements.
Un nouveau changement, se traduisant par des
conditions naturelles jugées comme positives, s'amorce lorsque l'on se
déplace en direction du sud vers la région des Grands Lacs. Aucune
réponse positive ne peut être apportée à la question de savoir s'il y a
eu, par le Nil, des liens entre la région des Grands Lacs et l'Égypte
ancienne. N. BLANC indique là encore que l'insuffisance de données
archéologiques laisse sans réponse satisfaisante les questions relatives
à l'histoire du peuplement dans cette région.
En conclusion, N. BLANC :
. réaffirme l'importance d'une approche
géographique pour saisir l'histoire des peuples nilotiques. Elle fournit
un élément d'explication au contraste offert entre par exemple l'Égypte
et la région située entre le 23e parallèle et les Grands Lacs.
. suggère de multiplier les études
régionales pluri-disciplinaires mais celles-ci devant se faire dans la
perspective de l'ensemble de la vallée du Nil.
. met en garde le chercheur :
"Il est
dangereux de laisser peser sur la formulation d'hypothèses de travail le
déséquilibre de l'historiographie classique ou les préjugés hérités du
siècle dernier. La présence d'une rupture géographique et de peuplement
au niveau du 10e parallèle a notamment véhiculé l'idée de l'existence de
deux vallées du Nil, l'une blanche civilisée, l'autre noire primitive.
Un tel stéréotype est particulièrement redoutable, car, fruit d'une
péripétie historique relativement récente (migrations arabes nord-sud)
dont l'origine est externe à la région, il tend à oblitérer la
possibilité de migrations antérieures de populations africaines vers le
nord."
- Parenté linguistique
génétique entre l'égyptien (égyptien ancien et copte) et les langues
négro-africaines modernes, par Théophile OBENGA.
(cf.
Le
peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture
méroïtique, Histoire générale de l'Afrique, Études et
documents 1, Paris, UNESCO, 1978, pp. 65-71).
Avant d'aborder la démonstration de la
parenté linguistique génétique entre l'égyptien ancien, le copte et les
langues négro-africaines modernes, le professeur Théophile OBENGA pose
trois préliminaires :
. Sa communication s'inscrit dans la
troisième catégorie des sources inventoriées par le professeur Jean
VERCOUTTER pour l'étude de l'origine culturelle des anciens Égyptiens.
Mettant en cause au plan scientifique les
travaux du professeur GREENBERG qui a créé la famille linguistique
afro-asiatique, tout en négligeant "une règle méthodologique
capitale", celle qui veut que soient établies les correspondances
phonétiques entre les langues d'une même famille, il est logiquement
conduit à formuler les préliminaires méthodologiques qui suivent.
. Le but visé est de démontrer l'existence
d'une parenté linguistique génétique entre l'égyptien ancien, le copte
et les langues négro-africaines modernes : "Depuis Ferdinand de
SAUSSURE, il est acquis que pour relier deux ou plusieurs peuples
culturellement, les preuves linguistiques sont les plus évidentes, les
plus pertinentes, les plus irrécusables".
Il convient toutefois de bien préciser la
différence qui existe entre "une parenté linguistique typologique qui
se fonde sur la concordance structurale des mots et des catégories
grammaticales" sans pour autant renseigner sur l'existence "d'un
ancêtre prédialectal commun" entre les langues comparées, et une parenté
linguistique génétique qui restitue "les formes antérieures communes à
partir de correspondances et de comparaisons morphologiques,
lexicologiques et phonétiques".
. Le troisième préliminaire méthodologique
est énoncé de la manière suivante :
"Est-on en droit de comparer l'égyptien
ancien et les langues négro-africaines modernes ?
Il est parfaitement légitime de le faire,
précisément pour démontrer l'identité d'origine des langues en question.
Et ce, même si nous n'avons pas, sous les yeux, tous les états
successifs des langues négro-africaines. La langue a une tradition orale
indépendante de l'écriture. Le lituanien, connu par des documents écrits
depuis seulement le XVIe siècle (1540), n'offre-t-il pas néanmoins, dans
l'ensemble, une image aussi fidèle de l'indo-européen que le latin du
IIIe siècle avant notre ère ?
Mais la comparaison doit reposer sur des
critères sûrs.
Les concordances morphologiques, phonétiques
et lexicologiques établies, selon la méthode comparative et inductive,
entre l'égyptien (ancien égyptien et copte) et les langues
négro-africaines modernes ne peuvent être fortuites, mais doivent
renvoyer à une identité originelle commune, parce que :
a) les critères de la comparaison sont
garantis par l'égyptien pharaonique qui est le plus ancien témoin des
langues comparées ;
b) la discontinuité géographique milite en
faveur de l'exclusion de l'emprunt dans ces temps anciens ;
c) la séparation très ancienne de la souche
commune élimine également l'emprunt sur l'ensemble des faits
morphologiques (grammaticaux), phonétiques et lexicologiques."
Théophile OBENGA établit ensuite les
concordances morphologiques (grammaticales) existant entre l'égyptien
(égyptien ancien et copte) et les langues négro-africaines modernes.
Elles concernent les catégories de genre sexuel, la formation
du pluriel, les formes complètes, les morphèmes négatifs,
le futur emphatique et enfin les particules de liaison.
Les langues africaines sollicitées sont le kanuri (Kanem Bornou), l'ewe
(Togo, Ghana), le bambara (Mali), le dyula (dialecte mandé), l'azer
(soninké médiéval), le dogon (Mali), les langues bantu (mbosi, kongo,
teke, etc.), le valaf (Sénégal).
Les débats
(cf. Le peuplement de l'Égypte ancienne
et le déchiffrement de l'écriture méroïtique, Histoire générale
de l'Afrique, Études et documents 1, Paris, UNESCO, 1978, pp.
73-125).
En accord avec les thèmes et les axes de
réflexion précédemment dégagés, le processus de peuplement de l'ancienne
Égypte, le degré d'homogénéité ou d'hétérogénéité de sa population,
l'appartenance anthropologique des anciens Égyptiens ont été abordés au
travers d'exposés oraux et de discussions sous divers angles d'attaque :
celui de l'archéologie, de la chronologie, des témoignages des Anciens,
des migrations, de l'anthropologie physique, de l'iconographie.
Le professeur SÄVE-SÖDERBERG fait état des
fouilles scandinaves au Soudan établissant les inter-relations entre la
vallée du Nil et l'Afrique septentrionale et saharienne. Il récuse la
possibilité "de fonder une étude du peuplement ancien de l'Égypte ou
tout autre similaire sur des définitions raciales … Il indique sa
préférence pour des études sur les relations des civilisations et des
cultures".
Le professeur Cheikh Anta DIOP, rappelle
d'abord que les découvertes du professeur LEAKEY conduisaient à admettre
que l'humanité a pris naissance en Afrique, dans la zone des sources du
Nil, impliquant un premier peuplement humain de la Terre ethniquement
homogène et négroïde. Il inscrit le peuplement de la vallée du Nil dans
un mouvement progressif allant du sud vers le nord et qui s'est
échelonné du Paléolithique supérieur à la Protohistoire. Pour lui le
fond de la population égyptienne prédynastique était nègre.
Il passe en revue l'ensemble des arguments
étayant la thèse d'une origine nègre des anciens Égyptiens :
-
l'examen des peaux de momies : "Soucieux d'apporter des preuves
positives, le professeur DIOP avait étudié un ensemble de préparations
faites en laboratoire à Dakar. Il s'agissait d'échantillons de peau
prélevés sur les momies provenant des fouilles de MARIETTE. Ils
révélaient tous — et le professeur DIOP a soumis ces échantillons aux
spécialistes participant au colloque — la présence d'un taux de mélanine
considérable entre l'épiderme et le derme. Or la mélanine, absente des
peaux des leucodermes, se conserve, contrairement à ce qui est souvent
affirmé, des millions d'années, comme l'ont révélé les peaux des animaux
fossiles. Le professeur DIOP a souhaité pouvoir effectuer le même type
de recherche sur les peaux des pharaons dont les momies sont conservées
au Caire."
- les données archéologiques de la
protohistoire
- les mensurations ostéologiques et les
groupes sanguins,
- l'iconographie,
- les témoignages des auteurs grecs et
latins, ceux des voyageurs tels que le philosophe VOLNEY, ou encore
celui constitué par le dessin du SPHINX exécuté par Vivant DENON lors de
l'expédition d'Égypte dirigée par BONAPARTE, (voir reproduction à la fin
du texte),
- les traditions biblique et coranique,
- la comparaison des faits linguistiques,
- les termes par lesquels les Égyptiens se
sont eux-mêmes décrits dans leur langue
Le professeur DEBONO fait le point sur ses
propres recherches archéologiques et anthropologiques : "Pour le
paléolithique supérieur, ses travaux dans la montagne thébaine ont livré
la preuve de l'existence de l'homme le plus primitif".
Il fournit des informations sur les
découvertes de restes humains intéressant le paléolithique supérieur,
l'épipaléolithique, le néolithique et le prédynastique.
Ses recherches dans la montagne thébaine ont
permis de prouver l'existence de l'homme le plus primitif. Il rappelle
qu'un fragment de calotte crânienne découvert en 1962 au Gebel Silsileh
(nord de Kom-Ombo) datant probablement du paléolithique moyen "constituait la plus ancienne trace humaine découverte en Égypte."
Il précise que ce même site avait livré
d'autres vestiges humains se rapportant respectivement au paléolithique
supérieur et à l'épipaléolithique. Les restes humains relatifs à
l'épipaléolithique attestent, selon le professeur AGUIRÉ qui les a
étudiés, "la présence d'un cromagnoïde apparenté peut-être à la race
de Mekta el Arbi en Afrique du Nord et Asselar."
S'agissant enfin du néolithique et du
prédynastique, les fouilles menées à El Omari (dans le nord de
l'Égypte), fournissent "de nombreux restes humains en bon état de
conservation." Référence est faite à l'étude du professeur DERRY sur
les différences raciales entre le nord et le sud aux époques concernées.
"Contrairement à ceux du sud, les ossements d'El Omari
s'apparentaient nettement à la prétendue race nouvelle des constructeurs
de la pyramide. Elle montrait des affinités sans doute libyco-asiatiques.
La civilisation méadienne, dont on a retrouvé les cimetières, l'un à
Méadi et l'autre à Héliopolis, a prouvé, par les témoignages dégagés,
l'existence d'une race assez semblable à celle d'El Omari."
Dans le domaine de l'iconographie, il pense
qu'il doit être possible de tirer des informations sur les contacts et
les déplacements entre peuples à partir de comparaisons faites avec :
. les représentations iconograhiques
humaines (figurines ou dessins sur les vases) trouvées dans la région
nord de l'Égypte (Fayoum, Mérimdé, El Omari), en Haute-Égypte et en
Nubie.
. les nombreux dessins rupestres découverts
en Haute-Égypte, en Nubie et dans d'autres régions de l'Afrique.
S'agissant de l'aspect linguistique, il
affirme l'utilité d'une reconstitution du langage préhistorique
égyptien.
Il aborde enfin la question du peuplement de
la vallée du Nil par l'étude des industries lithiques : leurs
caractéristiques typologiques, leur répartition géographique.
Le professeur LECLANT "a insisté sur le
caractère africain de la civilisation égyptienne. Mais selon lui, il
convenait de bien distinguer "race" et culture, comme l'avait fait le
professeur VERCOUTTER".
Il considère que "l'anthropologie
physique, en Égypte, n'en est qu'à ses débuts" et "que le
problème du peuplement de l'Égypte ancienne était considérable et ne
pouvait être résolu, pour le moment, par une approche synthétique encore
très prématurée".
Pour le professeur GHALLAB, ce n'est qu'au
"paléolithique tardif que la race noire s'est manifestée de
l'Atlantique à la mer Rouge". "Une culture nègre n'est apparue
vraiment qu'au néolithique".
Le professeur ABDALLA considère pour sa part
qu'il est "peu important de savoir si les Égyptiens étaient des noirs
ou négroïdes : le plus remarquable était le degré de civilisation auquel
ils étaient parvenus. Il existait a-t-il dit des indices importants
fournis par l'anthropologie physique concernant la présence de Noirs
dans le peuplement ancien, mais il était abusif de généraliser et de
dire que ce peuplement étaient entièrement noir ou négroïde".
Il aborde ensuite le volet linguistique en
indiquant qu'il n'a pas été convaincu par les démonstrations effectuées
par le professeur DIOP : "les similarités signalées étaient
accidentelles […] Les preuves fournies de parenté plaideraient bien plus
en faveur de la dispersion de l'égyptien ancien en Afrique que de sa
parenté avec les langues africaines actuelles". Pour lui "la
langue égyptienne n'est pas une langue africaine directe ; elle
appartenait à un groupe proto-sémitique, et de nombreux exemples
pouvaient être cités à l'appui de cette définition".
Le professeur SAUNERON intervient au cours
d'un vif échange entre les professeurs ABDALLA et DIOP portant sur la
traduction du terme égyptien km : il en confirme la
signification, noir, récusée initialement par le professeur ABDALLA.
Le professeur OBENGA poursuit la
démonstration linguistique commencée par le professeur DIOP et montre à
partir de toute une série de démonstrations comment il serait possible
dans le futur de "dégager un "négro-égyptien" comparable à
l'"indo-européen"".
Mme GORDON-JAQUET souligne l'intérêt d'une
approche toponymique pour "étayer l'assertion suivant laquelle il ne
s'est produit en Égypte aucune immigration ou invasion massive de
populations étrangères depuis l'époque néolithique au moins".
Le professeur Jean DEVISSE communique aux
participants les résultats d'une enquête iconographique relative à trois
manuscrits (nouvelles acquisitions de la Bibliothèque nationale
française) témoignant de la représentation d'Égyptiens libres "sous
les traits et la couleur de Noirs".
En résumé, les débats ont révélé la
persistance de désaccords importants sur l'origine anthropologique des
anciens Égyptiens :
"La conclusion des experts qui n'admettaient
pas la théorie d'un peuplement uniforme de la vallée du Nil des origines
jusqu'à l'invasion perse, énoncée par les professeurs Cheikh Anta DIOP
et OBENGA, a été que le peuplement de base de l'Égypte s'était mis en
place au Néolithique, en grande partie en provenance du Sahara et qu'il
avait uni des hommes venus du nord et du sud du Sahara et différenciés
par leur couleur. A cette théorie, les professeurs DIOP et OBENGA ont
opposé la leur, qui soulignait l'unité du peuplement de la vallée par
des Noirs et les progrès de ce peuplement du sud au nord."
Par contre dans le domaine linguistique, le
rapporteur écrit qu'"un large accord s'est établi entre les
participants". "Les éléments apportés par les professeurs DIOP et
OBENGA ont été considérés comme très constructifs. (…) Plus largement,
le professeur SAUNERON a souligné l'intérêt de la méthode proposée par
le professeur OBENGA après le professeur DIOP. L'Égypte étant placée au
point de convergence d'influences extérieures, il est normal que des
emprunts aient été faits à des langues étrangères ; mais il s'agit de
quelques centaines de racines sémitiques par rapport à plusieurs
milliers de mots. L'égyptien ne peut être isolé de son contexte africain
et le sémitique ne rend pas compte de sa naissance ; il est donc
légitime de lui trouver des parents ou des cousins en Afrique."
S'agissant de la culture égyptienne :
"Le
professeur VERCOUTTER a déclaré que, pour lui, l'Égypte était africaine
dans son écriture, dans sa culture et dans sa manière de penser. Le
professeur LECLANT a reconnu ce même caractère africain dans le
tempérament et la manière de penser des Égyptiens."
Le rapporteur, dans sa conclusion générale
indique que "La très minutieuse préparation des communications des
professeurs Cheikh Anta DIOP et OBENGA n'a pas eu, malgré les précisions
contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO,
une contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un véritable
déséquilibre dans les discussions."
Il insiste enfin sur le bilan
"incontestablement positif" du colloque.
Les recommandations
(cf. Le peuplement de l'Égypte ancienne
et le déchiffrement de l'écriture méroïtique, Histoire générale
de l'Afrique, Études et documents 1, Paris, UNESCO, 1978, pp.
101-103).
Les experts ont clos leurs travaux par une
série de recommandations concernant quatre domaines dans lesquels les
recherches devraient être prioritairement poursuivies :
- l'anthropologie physique : fixer des
normes très précises et aussi rigoureuses que possible relativement à la
définition de races et à l'identification raciale des squelettes
exhumés, examen du matériel humain disponible dans le monde entier
(études ostéologiques, études des peaux de momies), création d'un
département spécialisé d'anthropologie physique en Égypte,
- les migrations des populations : série
d'enquêtes archéologiques systématiques portant sur l'ancienneté de
l'occupation humaine du delta, les gravures et peintures rupestres, les
cultures matérielles anciennes, les sépultures non pharaoniques de
l'ensemble de la vallée du Nil, les vestiges paléo-africains dans
l'iconographie égyptienne et leur signification historique,
- la linguistique :"la coopération des
spécialistes de linguistique comparée devrait être mise à contribution
sur le plan international pour établir toutes les corrélations possibles
entre les langues africaines et l'égyptien ancien",
- la méthodologie inter et
pluridisciplinaire : études interdisciplinaires intéressant en
particulier les régions périphériques à la vallée du Nil comme le
Darfour, la région entre Nil et mer Rouge, la bordure orientale du
Sahara, la région nilotique au sud du 10e parallèle, etc.
V.
Le déchiffrement de l'écriture méroïtique
(Du 1er au 3 février 1974)
Ce
thème est introduit par le professeur Jean LECLANT dans sa communication
intitulée : "Le déchiffrement de l'écriture méroïtique : état actuel
de la question". Il signale qu' "A la suite des recherches […]
c'est un total de 900 textes environ dont le rassemblement et la
publication sous la forme d'un répertoire d'épigraphie méroïtique (REM)
est actuellement en cours au Groupe d'études méroïtiques (GEM) de Paris".
(cf. Le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de
l'écriture méroïtique, Histoire générale de l'Afrique, Études
et documents 1, Paris, UNESCO, 1978, pp. 110-111).
Il souligne aussi l'intérêt
présenté par l'utilisation de l'informatique tant du point de vue de
l'enregistrement des textes que de celui de certaines analyses pouvant
dès lors être rendues automatiques.
Le professeur SHINNIE
rappelle les trois méthodes d'approche possibles : la découverte d'un
texte bilingue, l'analyse interne de la structure de la langue, l'étude
comparée avec d'autres langues africaines.
Le professeur LECLANT se
rallie à la procédure proposée par le professeur DIOP et qui s'inspire
de la méthode, recourant à l'ordinateur, mise en œuvre à Léningrad par
le professeur KNOROSSOV pour le déchiffrement des hiéroglyphes maya :
combiner le plurilinguisme à la puissance de l'ordinateur, en postulant
une parenté du méroïtique avec les langues négro-africaines.
Le professeur SÄVE-SÖDERBERG
insiste sur l'importance de l'étude des langues du Soudan.
Le professeur OBENGA propose
que soient recensées les caractéristiques grammaticales du méroïtique
actuellement connues.
Les participants expriment
leur satisfaction pour les travaux réalisés par le Groupe d'études
méroïtiques de Paris.
Des recommandations précises
ont été faites pour poursuivre les travaux de recherches qui, s'ils ont
permis de déchiffrer l'écriture méroïtique, n'ont pas encore permis de
comprendre la langue méroïtique.
VI. Les acquis
Le colloque du Caire marque
une étape capitale dans l'historiographie africaine. Pour la première
fois des experts africains confrontent, dans le domaine de
l'égyptologie, les résultats de leurs recherches avec ceux de leurs
homologues des autres pays, sous l'égide de l'UNESCO.
La légitimité scientifique
de rechercher systématiquement les liens, quels qu'ils soient, pouvant
exister entre l'Égypte ancienne et le reste de l'Afrique noire a été
reconnue au plan international.
Le fait que l'Égypte
ancienne soit traitée dans le cadre de l'Histoire générale de
l'Afrique, la rédaction par Cheikh Anta DIOP dans le Volume II du
chapitre I intitulé "L'origine des anciens Égyptiens" (cf. l'Histoire
générale de l'Afrique op. cit. pp. 39-72), constituent deux
exemples des retombées directes du colloque du Caire.
Par ailleurs, dans
l'éditorial inaugural de la revue Ankh (cf. n°1, février 1992,
pp. 5-22) nous avions recensé tout un ensemble de travaux
(d'archéologie, de linguistique, de philosophie, d'anthropologie
physique, …) se rapportant à l'Égypte ancienne et à ses liens avec
l'Afrique subsaharienne. En s'y reportant, le lecteur constatera que
plusieurs des travaux cités répondent à l'une ou l'autre des
recommandations faites au colloque du Caire et qu'ils apportent des
éléments de réponse décisifs sur certaines questions, comme celle, par
exemple, de l'antériorité de la Haute-Égypte sur le delta du Nil dans la
genèse de la civilisation égyptienne ; signalons à ce sujet
l'information donnée par le Bulletin d'Information Archéologique
(BIA) dans son n° 5 couvrant la période janvier - juin 1992 :
" Abou Simbel — Une mission
archéologique mixte égypto-américaine a mis au jour une ville
archéologique préhistorique dans la région d'El-Nabta à l'ouest d'Abou
Simbel. L'histoire de cette ville remonte à neuf mille ans et démontre
que le désert occidental au Sud de l'Égypte fut le berceau de la
civilisation égyptienne. Dirigée par le Dr. Fred WENDORF, professeur
d'anthropologie à l'Université de Dallas, cette équipe scientifique
poursuit ses travaux de fouilles depuis sept ans avec la collaboration
de quelques archéologues et géologues. Le géologue égyptien, le Dr.
Mohamed ELBAHY, a déclaré que les résultats enregistrés par la mission
font probablement d'El-Nabta la plus vieille ville habitée par les
anciens Égyptiens. Furent également découverts des bâtiments
gigantesques en pierre qui seraient sans doute les restes d'un temple.
[EL-SAYED
EL-NAGGAR, "Découverte d'une ville antique remontant à neuf mille ans
à Abou Simbel", Al-Akhbar du 20 avril 1992]."
Ce thème de recherche
Égypte-Afrique noire se développe tout en faisant l'objet d'ouvrages
scientifiques nouveaux, parmi lesquels on peut citer à titre simplement
indicatif (d'autres références sont proposées au lecteur dans la section
bibliographie de ce numéro) :
- Egypt and Africa,
Nubia from Prehistory to Islam, Ouvrage collectif [Edited by W.
V. DAVIES, British Museum Press in association with the Egypt
Exploration Society, 1991, second impression 1993, London]. Dans cet
ouvrage, très riche de résultats de recherches archéologiques, le
professeur Jean VERCOUTTER est l'auteur d'un article intitulé "L'archéologie nubienne et soudanaise, Passé, Présent et Futur". Il
y écrit :
"Les récents travaux au
Ouadi Kubanieh et dans les "Playas" du désert occidental comme ceux
entre Ve et VIe Cataractes : de Kadero, SaggaI, Kadada, el-Ghaba,
devraient être étendus aux déserts ouest et est, si l'on veut discerner
l'une des composantes essentielles de la civilisation pharaonique
naissante, celle qui est venue du Sud"
(op. cit., p. 4),
- De l'origine
égyptienne des Peuls, de Aboubacry Moussa LAM [Paris, Khepera/Présence
Africaine, 1993],
- L'origine commune de
l'égyptien ancien, du copte et des langues négro-africaines
modernes - Introduction à la linguistique historique africaine,
de Théophile OBENGA [Paris, L'Harmattan, 1993],
- L'apport de
l'Éthiopie et de la Libye à l'élaboration de la civilisation pharaonique,
de Babacar SALL, [thèse de doctorat d'État, Univ. Dakar, oct. 1992],
- Le
Sahara ou
la Vallée du Nil ? Aperçu sur la problématique du berceau de l'unité
culturelle de l'Afrique noire, Les chemins du Nil
de Aboubacry Moussa LAM [Dakar, IFAN-Publifan/Khepera, 1994].
VII. Conclusion
A
l'issue du colloque du Caire, Cheikh Anta DIOP appelle de ses vœux une
réorientation des études égyptologiques qui doit s'accompagner d'un
dialogue avec les chercheurs africains.
"Ce colloque peut-être
considéré comme un tournant qui a permis à l'égyptologie de se
réconcilier avec l'Afrique et de retrouver sa fécondité. […] Le dialogue
scientifique sur le plan international est instauré et l'on peut espérer
qu'il ne sera pas rompu. A la suite des débats des participants n'ont
pas manqué d'exprimer leur volonté de réorienter leurs travaux vers
l'Afrique et d'intensifier leur collaboration avec les chercheurs
Africains ".
[Le
Soleil n° 1128, janvier 1974].
Depuis 1974, les découvertes
archéologiques, les études linguistiques, les études génétiques,
l'examen de la culture matérielle, l'analyse de la pensée philosophique,
etc. ne font que confirmer chaque jour davantage la fécondité de cette
voie de recherche conforme aux recommandations des spécialistes
internationaux réunis au Caire.

Cheikh Anta DIOP
démontrant la concordance absolue de la conjugaison du verbe kef,
"saisir" en égyptien ancien, en copte et en wolof (langue du Sénégal) au
colloque du Caire (1974). "Le professeur SAUNERON, après avoir noté
l'intérêt de la méthode utilisée puisque la parenté en égyptien ancien
et en wolof des pronoms suffixes à la troisième personne du singulier ne
peut être un accident, a souhaité qu'un effort soit fait pour
reconstituer une langue paléo-africaine à partir des langues actuelles",
(Actes du colloque du Caire sur Le peuplement de l'Égypte ancienne et
le déchiffrement de l'écriture méroïtique, Histoire générale de
l'Afrique, Études et documents 1, Paris, UNESCO, 1978, pp. 100 ; cf.
aussi Ankh n° 2, avril 1993, pp. 125-163). (Source : Le Soleil).

Une vue du colloque international du Caire
sur Le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de
l'écriture méroïtique (1974). De droite à gauche les professeurs :
W. KAISER (Allemagne), J. LECLANT (France), R. EL NADURI (Égypte), T.
OBENGA (Congo), S. SAUNERON (France), T. SÄVE SÖDERBERGH (Suède), P. L.
SHINNIE (Canada), J. VERCOUTTER (France). Les autres participants, parmi
lesquels Cheikh Anta DIOP étaient placés en face de ceux figurant sur
cette photo.
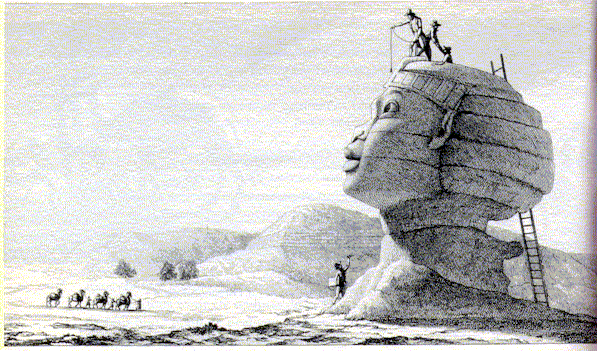
"Le Sphinx près des Pyramides"
— Dessin de Dominique Vivant DENON. Vivant DENON a accompagné BONAPARTE
dans l'expédition d'Égypte (1798-1799). Il est nommé membre de
l'Institut d'Égypte créé par BONAPARTE. Dessinateur, graveur, artiste,
Vivant DENON est aussi réputé pour son érudition. Sous NAPOLÉON, il est
nommé directeur du Musée du Louvre dont l'une des entrées porte
aujourd'hui son nom.
Il consigne ainsi sa "rencontre" avec le
Sphinx : "Je n'eus que le temps d'observer le Sphinx qui mérite
d'être dessiné avec le soin le plus scrupuleux, et qui ne l'a jamais été
de cette manière. Quoique ses proportions soient colossales, les
contours qui en sont conservés sont aussi souples que purs :
l'expression de la tête est douce, grâcieuse et tranquille ; le
caractère en est africain : mais la bouche, dont les lèvres sont
épaisses, a une mollesse dans le mouvement et une finesse d'exécution
vraiment admirables ; c'est de la chair et de la vie.", (Vivant
DENON, Voyage dans la Basse et le Haute Égypte pendant les campagnes
du Général BONAPARTE, Paris, 1ere édition Didot l'Aîné, 1802 ;
réédition, Pygmalion/Gérard Watelet, 1990, p. 109).Plus loin commentant
l'art égyptien, il écrit : "Quant au caractère de leur figure
humaine, n'empruntant rien des autres nations, ils ont copié leur propre
nature, qui était plus gracieuse que belle. … en tout, le caractère
africain, dont le Nègre est la charge, et peut-être le principe" (op.
cit., p. 168).

