|
La question de l'Âge du fer en Afrique
Louise Marie
Diop-Maes
Article publié dans
ANKH n°2
Résumé :
Dès 1952, H. LHOTE
avait montré, à l'encontre de la "théorie carthaginoise" de R. MAUNY, le
caractère autochtone de l'industrie noire-africaine du fer, sans que son
argumentation cohérente ait été retenue par les historiens de l'Afrique,
malgré la parution, en 1959, des premières datations de la "civilisation
de Nok" au Nigéria : -3500 BC, -2000 BC, -900 BC, +200 AD (L.M. DIOP,
1968).
Les dates les plus probantes produites ensuite sont 1°)
celles du massif de Termit : en 1972, 10e siècle BC; en 1988, 14e / 15e
siècle BC; en 1992, de 1675 à 2900 BC (cf G. Quéchon); 2°) celles de la
région du lac Victoria-Nyanza : 13e / 15e siècles BC, en 1982 (cf M.C.
Van GrunDerbeek, E. ROCHE, H. DOUTRELEPONT).
Les premières dates de Nok et celle de Ndalane, au
Sénégal (environ 2800 BC, cf. C.A. DIOP et G. DELIBRIAS, 1976) imposent
de multiplier les recherches et les datations dans ces deux régions.
Leur corrélation avec les dernières dates se rapportant au massif de
Termit, suggère que la métallurgie du fer est apparue en Afrique
occidentale vers 2800 BC, voire plus tôt.
Le fer trouvé en Asie et en Nubie est trop tardif pour
expliquer la présence en Égypte, de quelques échantillons de fer de
gisement, datant de l'époque des pyramides (27e siècle BC),
alors que l'Égypte est dépourvue de ce minerai. Il n'est pas impossible
que le fer soit venu du Soudan occidental et central par l'Ennedi (cf.
remarques de P. HUARD), dans le cadre d'un réseau d'échanges très
étendu, quand le Sahara était moins désertique.
Abstract : The Iron Age
in Africa —
H. LHOTE had shown as
early as 1952, contrary to R. MAUNY's "Carthaginian theory" the
autochtonous characteristic of Black Africa's iron industry, but his
consistent arguments had not been taken into consideration by historians
of Africa, in spite of the publication in 1959 of the first datations of
the Nok civilization in Nigeria : 3500 BC, 2000 BC, 900 BC, + 200 AD (L.
M. DIOP, 1968).
The most convincing dates produced later are 1°) those of
the Termit massif, in 1972, 10th century BC, in 1988, 14th/15th
centuries BC, in 1992, from 1675 to 2900 BC (cf. G. QUECHON), 2°) those
of lake Victoria-Nyanza region : 13 th/15th centuries BC, in 1982 (cf.
M. C. van GRUNDERBEEK, E. ROCHE, H. DOUTRELEPONT).
The first dates of Nok and Ndalane in Senegal (around
2800 BC, cf. C. A. DIOP and G. DELIBRIAS, 1976) impose us to multiply
investigations and datings in these two regions. Their correlation with
the last dates concerning the Termit massif, suggest that iron
metallurgy appeared in Western Africa around 2800 BC, if not earlier.
The iron found in Asia and in Nubia is too late to give
an explanation for the presence in Egypt, of a few samples of an iron
deposit dating back to the Pyramid period even though Egypt is lacking
in this ore. It is not impossible that the iron should have come from
Eastern and central Soudan by Ennedi (cf. notes by P. HUARD) in the
framework of a very large spread network of exchanges, when the Sahara
was less a desert.

Le soufflet à pied qui apparaît en Égypte
ancienne au Nouvel Empire. Tombe de Rekhmiré (Thèbes, n°100) où sont
représentées des techniques de la métallurgie.

Soufflet de forge, Marka, Mali. Musée de
l'Homme (Trocadéro, Paris) Le forgeron en Afrique noire. Il s'agit
d'un soufflet à pied dont l'usage est attesté au Nouvel Empire égyptien
comme l'illustre la reproduction ci-dessus.
Ce sujet est toujours à
l'ordre du jour [1]
1. La théorie de l'origine extra-africaine et la
théorie de l'origine autochtone
Dans son article "La connaissance du fer en Afrique
occidentale"[2], dès 1952 et avant toute datation, H.
Lhote, récemment décédé, avait bien vu que l’industrie du fer en Afrique
noire était autochtone et ne venait pas de l’Afrique du Nord par le
Sahara (contrairement aux affirmations de R. Mauny dont le point de vue
imaginaire prévalut sans raison valable) [3].
H. Lhote, à qui il convient de rendre hommage, observa
1. que le soufflet à coupe en
poterie est original et proprement soudanais
2. que les Berbères sahariens
ne sont pas des métallurgistes : ils méprisent le travail du fer (les "Enaden"
sont surtout des réparateurs)
3. qu’il n’a pas été trouvé de
traces de hauts-fourneaux au Sahara où pourtant le fer existe et que les
Sahariens ne connaissent pas, par eux-mêmes, cette technique ;
4. qu’au contraire, de nombreux
vestiges de hauts-fourneaux existent en zone soudanaise jusqu’au 16 e
parallèle [4] au nord
5. que la limite nord des
hauts-fourneaux se trouve approximativement à la limite sud de la racine
linguistique BRZL qui désigne le fer en langues sémitiques.
Il conclut que :
"Les faits ethnographiques, linguistiques, historiques
et archéologiques se conjuguent pour affirmer le caractère proprement
africain de l’industrie du fer dans le monde noir".
Pour R. Mauny, les Noirs ne pouvaient être, a priori,
que des esclaves auxquels les Berbères "confiaient les travaux
pénibles"[5], comme le travail du fer. Mais il faut en même
temps que ceux auxquels on confie ce travail ne le connaissent pas car,
par définition, ils doivent être non seulement esclaves, mais aussi
incapables de trouver eux-mêmes les procédés d’extraction et de
transformation du minerai de fer. Mais comme les Berbères ne le
connaissaient pas non plus, comment l’ont-ils appris à leurs présumés
esclaves noirs ? Alors, R. Mauny a recours à l’explication suivante :
dans la seconde moitié du 1er millénaire avant J.C. les Berbères
sahariens (non initiés aux techniques du fer) ont razzié leurs artisans
métallurgistes en Afrique du Nord "pour amener de proche en proche
l’industrie du fer des rives de la Méditerranée jusqu’aux lisières du
monde noir"[6]. C’est la même idée qu’il exprimait plus haut
avec plus de précision : "les 'mallems' amenés du nord avaient
certainement pour les aider des esclaves du maître pour lequel ils
travaillaient" (esclaves, c’est-à-dire esclaves noirs). En clair, il
faudrait admettre : 1) que des forgerons "razziés" au nord du Sahara ont
enseigné leur technique à des esclaves noirs razziés au sud par les
mêmes maîtres berbères, 2) que ces aides-forgerons noirs, soit qu’ils
aient réussi à s’enfuir, soit qu’ils aient été "envoyés exprès pour
les commodités d’approvisionnement en métal"[7], ont alors
implanté l’industrie du fer en Afrique occidentale. Cette transmission
et cette translation étant assurées dans la deuxième moitié du 1er
millénaire avant J.C. par les "maîtres" berbères, eux-mêmes non initiés
à cette technique, et tout cela :
– bien que le fer ne soit devenu courant dans les tombes
d’Afrique du Nord qu’au 3 e
siècle BC alors qu’au 4e BC des "Éthiopiens" de la côte
atlantique (Cerné), "se servaient de traits durcis au feu" et qu’au 5e
siècle BC au moins, l’industrie d’extraction du fer est déjà attestée à
Nok (Nigéria) ;
– bien qu’on ne trouve aucune parenté linguistique entre
les manières de dire "le fer" en Afrique du Nord d’une part, au Soudan
d’autre part ;
– bien qu’il n’y ait pas trace de hauts fourneaux au
Sahara.
Cette théorie se révélait donc à l’analyse comme une
construction de l’esprit reposant sur des idées préconçues et non sur
des faits.
Les seuls éléments ethnographiques, linguistiques,
historiques, géographiques, archéologiques que l’on avait pu dégager,
contredisaient l’hypothèse d’une introduction de l’industrie du fer en
Afrique Noire par l’Afrique du Nord et le Sahara. Aux faits mis en
évidence par H. Lhote dès 1952, on pouvait ajouter d’autres
considérations.
Le forgeron occupe une place considérable dans la vie
traditionnelle africaine, soit dans les légendes, soit par les fonctions
importantes et diverses que le forgeron et sa femme exerçaient dans le
village d’Afrique noire. Le culte du dieu Gou ou Ogun, dieu du fer et de
la guerre, incline aussi à supposer le caractère traditionnel de cette
industrie dans la société africaine.
Les grands Empires noirs, sahéliens ou soudanais, du plus
ancien (Ghana) au plus récent (Songhaï) mordaient largement sur le
Sahara dont de vastes portions étaient directement administrées par des
gouverneurs noirs [8].
Qui nous dit qu’avant les invasions arabes, les Berbères
étaient les plus nombreux et les grands vainqueurs au Sahara central et
méridional ?
Les populations noires vivant jadis au Sahara, et
ultérieurement soumises par les musulmans arabo-berbères dans les oasis
et les massifs montagneux, ont très bien pu constituer alors, et alors
seulement, ces "castes méprisées" de forgerons, comme les Haddads [9],
mais qui connaissaient, probablement depuis de nombreux siècles, le
travail du fer. D’autre part, rappelons ici que les "Haratins" ne sont
pas seulement des esclaves noirs amenés là par des caravaniers et
trafiquants d’esclaves, mais représentent aussi, peut-être surtout, un
peuplement résiduel du Sahara néolithique, humide et négroïde.
A cette polémique, les articles détaillés de P. Huard
apportaient des éléments supplémentaires[10]. Il écarte, par
exemple l’origine libyco-berbère de la sagaie teda[11]. Il
rapporte, d’après V. Pâques, deux traditions sur l’introduction de la
métallurgie au Fezzan : à Sebba, par des Juifs venus du nord, à Ghât par
des forgerons venus du Soudan[12]. Le groupe passe, écrit-il, "pour
avoir été l’un des premiers à avoir travaillé le fer au Tchad..., les
Zaghawa sont mentionnés depuis le 8 e
siècle par les chroniqueurs arabes... Ils ont conservé la pratique des
sacrifices agraires qui se concilie mal avec une islamisation supposée
vieille d’un millénaire"[13].
Comment les chroniqueurs arabes décrivent-ils les Zaghawa ?
– Ibn Munabbet
(738) "compte les Zaghawa parmi les peuples du Soudan" ;
– Idrisi
(12e
siècle) "les dépeint comme des nègres chameliers occupant la zone
comprise entre le Fezzan et le Chari, le Xaouar et le Darfour" ;
– Ibn Khaldoun
(14e
siècle) "compte parmi les royaumes noirs du Soudan, les Zaghawa".
Dans l’Ennedi, P. Huard a montré "l’importance des
témoignages figurés et des vestiges archéologiques concernant
l’ancienneté du travail du fer". "Le poignard de bras dont l’aire
très étendue, écrit-il, va du Nil au Hoggar et au Moyen-Niger, est
figuré à Halléma (corne nord-est de l’Ennedi) au bras d’un lancier
habillé, d’âge du fer avancé, finement gravé avec son troupeau de
boeufs, dont deux ont des cornages déformés, pratique des pasteurs du
groupe C de Nubie, qui s’est propagée dans tout le Sahara tchadien et
encore attestée au Tibesti à l’âge du fer"[14].
Cependant, en 1964, donc onze ans après l’exposé des
théories opposées de H. Lhote et de R. Mauny (1952-1953), à la suite et
en dépit des observations qu’il a faites et qu’on vient de rapporter, P.
Huard admettait néanmoins dans la première partie de ses conclusions,
sans la moindre réserve et sans que l’on comprenne par quel
raisonnement, l’hypothèse d’une transmission lente et progressive du fer
méditerranéen au monde noir de la manière suivante
1. 3 e
siècle avant J.C. : arrivée par trafic indirect du fer ouvré provenant
du domaine carthaginois ("datation proposée par R. Mauny")
2. 4 e
siècle après J.C. : acquisition par les noirs soudaniens du travail du
fer d’origine méditerranéenne ("datation due à W. Cline").
Et pourtant il ajoutait :
"Les traces d’un apport antique possible du fer
méditerranéen aux cornes nord-est et nord-ouest du Tibesti sont
recherchées sur le terrain"[15].
Ce qui laisse supposer que, jusqu’ici, les traces d’un
tel apport n’ont pas encore été trouvées.
Par contre, on retiendra comme éléments importants de ses
conclusions les propositions suivantes:
- "Ce qui a été dit des métaux dans le centre du Tchad
et à l’ouest du lac montre que les questions qui s’y rattachent
débordent - territorialement et par leur portée - le cadre des confins
sahariens, dont l’intérêt est d’avoir enregistré latéralement des
témoignages de transmission est-ouest dans la zone de parcours entre le
Nil et le Niger, où le fer s’est inscrit parmi les facteurs d’une
évolution ayant abouti à la création d’états organisés".
- "Mais du Tchad au Mossi, les éléments traditionnels
recueillis, se rapportant à l’âge local des métaux, sont déformés,
fragmentaires et non coordonnés, et ils restent à mettre à leur place
respective au sein des courants issus de la vallée du Nil, dont W AINWRIGHT
au Nigéria et Arkell au Ghana ont mis en évidence des faits limites de
transmission matérielle ou culturelle"[16].
En résumé, si l’on n’avait aucune preuve tangible d’un
courant nord-sud de l’industrie du fer à travers le Sahara, en revanche,
des témoignages variés, particulièrement archéologiques, permettaient
d’affirmer une parenté de l’industrie ancienne du fer dans une zone très
vaste allant du Nil au Tibesti, d’une part, au Tchad et à l’ouest de ce
lac, d’autre part, en passant par l’Ennedi.
On en déduisait qu’il avait pu y avoir transmission
latérale d’est en ouest, non seulement à travers le Sahara méridional,
mais aussi à travers tout le Soudan du Nil au Niger, le point de départ
étant dans les deux cas, la Nubie.
Cependant, en l’absence de datation certaine, tant pour
les débuts de l’industrie du fer en Nubie que pour tous les autres sites
signalés au Soudan central, occidental et ailleurs, cela pouvait
également signifier une immense aire de dispersion de l’industrie du
fer, avant même les migrations de population qui se seraient produites à
partir de la vallée du Nil vers l’ouest, le sud-ouest et le sud depuis
le 6e siècle BC environ[17].
En effet, concernant l’âge de la métallurgie du fer au
Nigéria, Basil Davidson signale dans son ouvrage L’Afrique avant les
Blancs [18] que "quatre fragments de charbon de ces étages
de Nok ont révélé au radio carbone des datations d’environ 3500, 2000,
900 BC et 200 AD".
L’auteur rapporte ensuite le commentaire suivant de
Bernard Fagg :
"Les deux premières dates proviennent presque
certainement de sédiments plus anciens, tandis que – 900 avant J.C.
(environ le commencement de la pluviation de Nakura) et 200 après J.C.,
marquent probablement les limites supérieures et inférieures de la
civilisation des figurines de Nok".
Il est ici nécessaire d’attirer l’attention sur le fait
que la supposition selon laquelle les deux premières dates
proviendraient de sédiments plus anciens, est gratuite. On reste
circonspect devant les interprétations tendant à rajeunir les faits en
dépit des résultats objectifs fournis par les méthodes scientifiques.
On ne s’explique guère quelle constatation archéologique
a conduit P. Huard à faire la remarque suivante[19].
"B. F agg
a réduit récemment quelque peu l’obstacle que ces datations opposent à
une future explication d’ensemble de la diffusion du fer dans l’Afrique
de l’Ouest en écrivant :
'On pense maintenant que la culture de Nok
est le produit d’une révolution qui s’est produite autour de
l’introduction du fer et qui fut probablement florissante entre –400 (probablement
pas aussitôt que –900) et +200'. "Dans le contexte général
de cette étude, poursuit Huard, c’est évidemment la fin de cette
période qui nous paraît seule recevable".
Nous ne voyions naturellement aucune raison de le suivre
dans cette opinion.
Dans la région tchadienne, le bovidien récent, époque à
laquelle l’usage du fer est attesté, est considéré comme datant du 1er
millénaire BC. Or, P. Huard note que "dans le bovidien récent de
l’Ennedi, le style de Fada, que nous avons considéré comme antérieur au
fer, a livré à Bailloud des lances à armatures". D’autre part, le
groupe C de Nubie (auquel un lancier accompagné d’un troupeau de bœufs,
figuré dans la corne nord-est de l’Ennedi, est apparenté) débute, selon
Arkell, à la fin du 3e millénaire BC (entre –2300 et –2150) [20].
Ainsi, dès 1967-68, l’analyse des faits et des arguments
me permettait de conclure :
1. que selon toute probabilité,
la métallurgie du fer dans le continent africain est autochtone et n’y a
pas été introduite par des influences extérieures ;
2. que cette industrie ancienne
et traditionnelle est restée très vivace jusqu’à l’époque de la
colonisation ;
3. que l’on a affaire à des
civilisations transitionnelles, sidérolithiques (dans lesquelles les
industries de la pierre et du fer coexistent) selon l’expression de W.
Fagg ;
4. que l’établissement d’une
chronologie pour l’Afrique noire n’en est encore qu’à ses premiers
balbutiements. L’imprécision est telle que l’on pourrait aussi bien
considérer que l’Âge du fer a pu débuter au cours du 3e millénaire BC,
qu’au cours du premier (Nok) ;
5. que les découvertes
archéologiques qui ont été faites jusqu’ici ont révélé, comme principaux
sites d’une industrie sidérolithique, le Nigéria, le Mali, le Tchad, la
Zambie, la région des Grands Lacs. Mais cette liste n’est nullement
limitative. Le professeur Hiernaux signale que la dimple based
pottery a été récemment découverte au Kasaï (Congo). Et William Fagg
écrit : "Il est bien possible que l’on ne connaisse pas certains
vestiges de cultures anciennes, profondément enterrés et qui n’ont pas
la chance de se trouver au milieu de roches susceptibles d’être
analysées". Il exprime plus loin l’idée que bien des civilisations
enfouies dans le sol de l’Afrique risquent de ne jamais revoir le jour.
Dans cet ordre d’idée, un autre facteur qu’on ne saurait
surestimer est la vitesse de disparition par oxydation de tous les
objets en fer sous les climats chauds et humides d’Afrique ;
6. que, dans ces conditions, il
paraît tout à fait prématuré d’affirmer quels ont été les premiers
centres de diffusion du fer en Afrique et quelles furent les routes de
diffusion du fer à travers l’Afrique, d’autant que les différents
centres métallurgiques déjà trouvés semblent se situer tous dans une
Antiquité assez lointaine. Le professeur HIERNAUX a écrit en 1962 : "Si
nous sommes tentés de regarder vers Méroé, où les scories de fer forment
des amas importants, lorsque nous cherchons le foyer de la métallurgie
en Afrique centrale et orientale, nous devons en fait attendre
des données plus étoffées, avant de pouvoir formuler des hypothèses
suffisamment étayées"[21].
S’il semblait donc prouvé, dans les années soixante, que
la métallurgie traditionnelle du fer en Afrique était très ancienne,
largement répandue et autochtone, il restait, par contre, à déterminer
les foyers d’origine de cette métallurgie, leur datation exacte et les
hypothétiques routes du fer à travers le continent [22].
Toutes ces considérations n’empêchèrent nullement que
l’on continue à enseigner imperturbablement le tracé de la transmission
des techniques du fer depuis l’Afrique du Nord jusqu’au Soudan
occidental à travers le Sahara. On oublia même que c’était Henri Lhote
qui découvrit les caractères original et autochtone de l’industrie du
fer en Afrique occidentale.
2. Les
confirmations de l'invention autochtone
de la
métallurgie du fer
Malgré l’accumulation des datations, lente il est vrai,
il faudra attendre le premier colloque international de l’archéologie du
Cameroun tenu à Yaoundé du 6 au 9 janvier 1986, et dont les actes
viennent d’être publiés [23], pour trouver enfin la phrase
suivante :
"De longues et stériles querelles ont conduit certains
chercheurs à s’opposer aux résultats évidents des recherches
archéologiques. La cause semble bien, aujourd’hui, entendue. Les
fondeurs étaient des Noirs..." [24].
Encore l’auteur fait-il allusion, ici, surtout au cuivre.
A propos, d’une industrie microlithique du nord-est du
Zaïre, le préhistorien belge F. Van Noten a écrit [25] : "L’industrie
d’Ishango a été datée de 21 000 +/- 500 BP soit 19 000 BC, ce qui avait
paru trop vieux... Mais vu les dates obtenues à Matupi, ce résultat
semble aujourd’hui moins improbable". Voilà comment ont été écartés,
systématiquement, des faits et des dates qui ne cadraient pas avec la
vision qu’on a des choses. En 1984, dans leur important ouvrage "La
datation du passé, la mesure du temps en archéologie"[26], R.
P. Giot et L. Langouët spécifient que, contrairement à ce qu’on dit,
une seule date est déjà une indication (mais qui nécessite
confirmation), et que la qualité de
l’échantillon, à tous points de vue, est l’élément essentiel.
Il faut souligner le fait que les dépôts de Nok ont
fourni des haches en fer "encore de la forme grossière de la pierre"[27].
D’où l’appellation de civilisations "sidéro-lithiques" que W. Fagg donne
à ces cultures qui passent directement de la pierre au fer et continuent
de développer parallèlement ces deux industries.
D’autre part, en 1976, C.A. Diop commentait les datations
de Nok de la manière suivante :
"Des figurines de Nok trouvées en place, à 12 m de
profondeur avec des scories, des tuyères, ont pu être datées au 14C
grâce à des brindilles de bois carbonisé associées. Les âges obtenus
sont les suivants : 3500 BC, 2000 BC, 900 BC. Ces dates sont peut-être
excessives pour l’âge du fer en Afrique, mais aucun des arguments
avancés pour les rejeter n’est scientifiquement valable, ou consistant.
Il convient donc de les prendre en considération, sous réserve que
d’autres faits viennent les confirmer ou les infirmer.
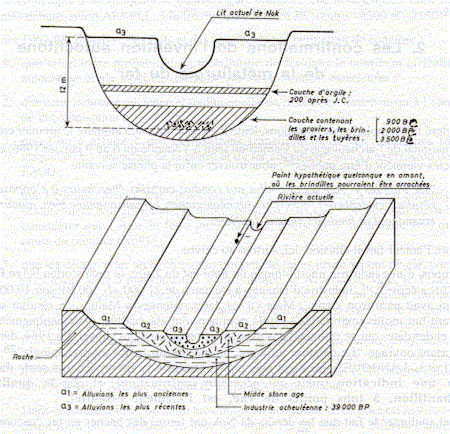
Fagg a omis de fournir un schéma intelligible de la mise
en place, par alluvionnement des brindilles (matériaux polluants) ; on
remarquera qu'il est impossible d'atteindre la zone (supposée) de
provenance des brindilles, en amont, sans arracher auparavant d'autres
brindilles contemporaines du ravinement, c'est-à-dire de l'âge
conventionnel du fer (500 BC), et que l'on aurait dû trouver associées
avec les premières d'âge plus ancien : ce qui n'est pas le cas.
L'idée de Fagg, selon laquelle la méthode du 14C n'était
pas encore au point au moment où les dates ont été effectuées, est
fausse et ne doit pas être retenue.
Le diagramme d'interprétation ci-dessus correspondrait, à
peu près, à l'idée que les inventeurs des dates se font de la mise en
place des matériaux, ainsi que cela a semblé ressortir de la
conversation que j'ai eue avec le professeur Th. Shaw à ce sujet lors du
congrès de l'U.I.S.P.P. en septembre 1976 à Nice.
Or, la fouille d’un tumulus au Sénégal à 25 km de Kaolack
(Ndalane) a révélé des faits qui ont été jugés aberrants par leur
inventeur G. Thilmans, IFAN, Dakar [cf. C. A. Diop, "Datations par la
méthode du radiocarbone, série III", Bulletin de l’IFAN, t. XXXIV, série
B, n° 4, 1972, pp. 678-701. Voir p. 690 DaK-110 et DaK-111.].
La datation croisée par Dakar et Gif-sur-Yvette, dans des
conditions choisies par l’inventeur, de charbons recueillis en place, à
330 cm de profondeur, a donné les résultats suivants :
DaK-110 = 4811 +/- 137 BP soit 2861 +/- 137 BC
GIF-2508 = 4770 +/- 115 BP soit 2820 +/- 115 BC
résultats d’autant plus significatifs si l’on sait que
Mme Delibrias, à Gif, n’était pas au courant des valeurs que j’avais
obtenues.
Or, il importe de souligner que l’on a extrait de ce
tumulus tout un outillage en fer et en cuivre associé à un Néolithique
finissant, de tradition capsienne. La difficulté vient du fait, qu’au
premier abord, on n’oserait pas faire remonter ce matériel à une époque
aussi lointaine.
Bien que la méthode de datation par la thermoluminescence
soit encore semi-empirique [28],
il serait intéressant de l’utiliser pour tester les tuyères de Nok et la
poterie du tumulus de Ndalane ; cela permettrait de trancher rapidement
la question.
Enfin, des datations que nous avons établies pour M.
ROSET, hélas dans de très mauvaises conditions de prélèvement, que
celui-ci avoue, si elles sont confirmées, feront passer l’âge du fer au
Sud-Sahara du 5e siècle avant J.C. au 10e avant J.C. "massif du Termit".
DaK-145 = 2628 +/- 120 BP soit 678 BC
DaK-147 = 2924 +/- 120 BP soit 974 BC
DaK-148 = 1747 +/- 110 BP soit 203 après J.C.
Les faits ci-dessus indiquent que nous allons peut-être
vers une remise en cause de l’âge du fer en Afrique noire.
[29] "
Depuis lors, de nouvelles recherches ont été menées dans
différentes régions et d’autres dates fournies.
En fait, dans l’ouest de la région même de la culture de
Nok, à Taruga, des datations supplémentaires ont été obtenues, la plus
ancienne remontant au 9e siècle BC [30]. Au nord de cette région,
dans le district du massif de Termit, Niger oriental, l’abondance des
vestiges d’une métallurgie ancienne du fer (fourneaux, scories,
creusets, objets divers) permit à J. P. Roset et G. Quéchon de faire
dater quatre échantillons de charbons au laboratoire de l’IFAN à Dakar
(C.A. Diop), nous venons de le voir. Ils publièrent les résultats en
1974 dans les cahiers de l’ORSTOM [31]. La date la plus ancienne
faisait remonter à 974 BC environ l’âge du fer dans le secteur ouest du
massif de Termit [32]. Ce que d’aucuns jugèrent peu plausible.
Mais à la suite de nouvelles fouilles effectuées par G. Quéchon,
d’autres datations ont été fournies par deux laboratoires des
Universités de Paris (J. Ch. Fontes et J. F. Saliège). De nouveau, on
constate non seulement qu’elles confirment les précédentes, mais
qu’elles situent l’Age du fer dans le 2 e
millénaire BC, avant 1350 [33]. De telles dates excluent, bien
évidemment, la prétendue origine nord-africaine de la métallurgie du fer
en Afrique subsaharienne occidentale et confirment la justesse du
raisonnement de H. Lhote sur cette question.
Tout cela n’empêche malheureusement pas C.
Coquery-Vidrovitch d’écrire encore en 1993 que la civilisation de Nok
aurait appris la technologie du fer "à partir d’influences
carthaginoises", par l’intermédiaire du Sahara central [34],
énoncé plus confirmé qu’infirmé par la phrase suivante, à propos de la
métallurgie de l’Afrique occidentale :
"les dates et le style des fours étant plus anciens
que l’industrie du fer de Méroé, on en a conclu que la technologie était
soit autochtone, soit, plus probablement, diffusée à partir de
l’Afrique du Nord punique" [35]. (Souligné par nous).
En outre, dans le Journal des Africanistes (62, 2,
1992 : pp. 55-68), en association avec F. Paris, A. Person et J.F.
Saliège, Gérard Quéchon écrit :
" … dans la région d’Egaro (Ouest de Termit), deux
poteries provenant de sites qui ont livré des objets en fer, ont fourni
des dates encore plus anciennes : 2520 et 1675 BC et même
2900-2300 BC d’autre part. Ces dates ont été obtenues dans de
bonnes conditions de fiabilité, en laboratoire (S aliège,
Lodyc, Univ. P. et M. Curie) comme sur le terrain (mission Paris
et Quéchon, 1986)".
(Souligné par nous).
" La probabilité que l’âge calibré soit
situé dans cet intervalle de temps est de 95% (intervalle de confiance
2a). La table de calibration utilisée est celle de Klein
et al. 1982"[36].
Certes les auteurs publient ces deux dates
"avec toutes les réserves d’usage" et "en attendant confirmation par
d’autres résultats", mais le rapprochement avec la date obtenue à
Ndalane (Sénégal) s’impose (cf. ci-dessus publication C. A. Diop,
in Notes africaines, n°152, octobre 1976, IFAN, Dakar),
ainsi qu’un réexamen des couches inférieures de Nok et des sites
environnants.
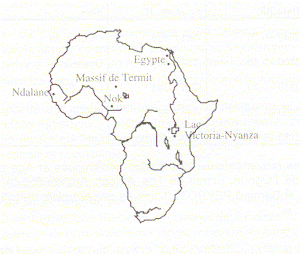
Figure 2 :
Localisation des sites datés les plus anciens de l'âge du fer en Afrique
(entre 900 BC et 2900
BC).
Dans l’ouvrage, par
ailleurs clair, précis et bien documenté de Marianne Cornevin, qui
restitue habituellement l’historique des recherches, l’argumentation
pertinente de H. Lhote (1952) est totalement passée sous silence ainsi
d'ailleurs que l'article de C. A. DIOP, ci-dessus cité (1976) et le mien
(1968). La suggestion d’une invention indépendante de la métallurgie du
fer au sud du Sahara et la mise en doute de la "théorie carthaginoise" y
sont présentées comme datant de 1985, avec un article de D. W.
Phillipson dans African Archaeology ! (p. 119).
Dans sa contribution à Métallurgies
Africaines [37], intitulée "Les métallurgies du cuivre et
du fer autour d’Agadez...", D. Grebenart indique que l’Âge du fer
ancien est représenté par une quarantaine de sites implantés au sud de
la falaise de Tigidit (p. 114). "Il commence à partir de 500 BC
environ et semble avoir eu une origine méridionale" (p. 110)
(souligné par nous). Depuis, il a trouvé des dates plus anciennes (9e
siècle).
Dans le Nord-Cameroun, A. Marliac a obtenu
un Âge du fer à 700 BC, couche plancher [38]. Il faudrait pouvoir
creuser plus profondément. Au Gabon, l’Âge du fer débute vers 600 BC
[39], ou même peut-être plus tôt.
|
Dates calibrées |
|
N° de labo |
Date BP |
av. et ap. JC |
Sites |
Associations |
|
Beta 14834
Gif 7130
Gif 7774
Beta 15067
Beta 15063 |
2640 +/- 70
2400 +/- 50
2310 +/- 70
2260 +/- 120
2130 +/- 110 |
-961 / -559
-752 / -401
-736 / -203
-740 / -38
-390
/ +72 |
Otoumbi 2a
Otoumbi 2a
Lopé 10
Otoumbi 5
Lopé 4 |
Four
Four
Four
Céramique, scories
Four |
Tableau :
Mesures radiométriques des stades néolithiques et Age du Fer Ancien de
la moyenne vallée de l’Ogoué. Extrait de The African
Archaeological Review, 10, 1992, Richard Oslisly et Bernard Peyrot,
"L’arrivée des premiers métallurgistes sur l’Ogoué, Gabon".
"Au Gabon dans la moyenne vallée de l’Ogoué, dès ca
2600 BP, des fondeurs sont présents mais de manière ponctuelle et isolée
sur les sites d’Otoumbi 2 (2 640 +/- 70 et 2 400 +/- 50 BP) et de Lopé
10 (2 310 +/- 70 BP) ; ils ne laissent curieusement aucun vestige de
céramique (O slisly
1992a). Plus tard des fondeurs apparaissent à Moanda dans le Haut Ogoué
ca 2300 - 2100 BP (Schmidt et al. 1985), près d’Oyem ca 2280 BP (Clist
1989) et dans l’est du pays à Makokou ca 2150 BP (Peyrot et Oslisly
1987)".
Les auteurs indiquent également que :
"sur les rives de la moyenne vallée de l’Ogoué, c’est
vers 2300 - 2200 BP que l’on assiste à une nette expansion des fondeurs
de tradition Okandienne identifiée sur les sites d’Otoumbi 5 (2 260 +/-
120 BP) et Okanda 2 (2110 +/- 70 BP), qui vont largement dominer
l’espace des enclaves savanicoles de la réserve de Lopé / Okanda (sites
d’Okanda et Lindili) jusqu’à ca 1 900 - 1 800 BP".
Si nous nous portons en Afrique centre-orientale ou "interlacustre",
les travaux de Marie Claude Van Grunderbeek, Émile Roche et Hugues
DOUTRELEPONT y ont révélé "des traces très anciennes" de la métallurgie
du fer [40]. Les dates obtenues au Burundi (ca 1 230 BC au
site de Rwiyange I, ca 1 210 BC, au site de Mubuga V) sont mises
en parallèle avec les datations se rapportant aux sites bordant le lac
Victoria : ca 1470, ca 1250 et ca 1080 BC (à
Katuruka, rive sud du lac). Autrement dit, c’est au 13e siècle BC et
peut-être au 15e que l’Âge du fer est attesté dans cette région. D’où la
conclusion des auteurs :
"Au vu de la grande ancienneté de certaines datations,
les hypothèses émises quant à la diffusion de la technologie du fer en
Afrique interlacustre mériteraient d’être reconsidérées".
Contrairement aux théories soutenues par M. Guthrie et
J.H. Greenberg (et généralement admises), F. Van Noten pense que la
connaissance du travail du fer n’est pas liée à une "expansion Bantu",
car :
"On constate, en comparant, dans les langues bantu,
les termes en rapport avec la métallurgie, qu’il existe une grande
diversité pour des termes importants du vocabulaire de la forge".
[41]
"Cependant,
poursuit-il, quelques reconstructions font penser à un usage du fer au
niveau du proto-bantu, tels forges, marteau et soufflet... Enfin,
d’autres termes de la métallurgie paraissent avoir une origine identique
dans les langues bantu et non bantu... il est difficile d’admettre que,
si les "Bantu" travaillaient le fer avant leur expansion, nous n’en
trouvions pas de traces linguistiques évidentes".
"En l’absence
d’écriture, l’archéologie ne permet pas d’établir de corrélations
directes entre les documents de l’âge du fer et la notion linguistique
de bantu "[42].
Th. Obenga
[43] rappelle que maints peuples africains désignent le fer "par la
même métaphore que les clans égyptiens" : métal du ciel. Ce qui repose,
en même temps, la question de l’origine du fer en Égypte pharaonique et
en Nubie, par rapport au fer de l’Afrique orientale, centrale et
occidentale. A ce sujet,
C.A. Diop écrivait :
"L’usage
du fer de minerai, par opposition au fer météorique, est attesté en 2
600 avant J.C. en Égypte, par plusieurs spécimens de fer doux
[44]; on n’a jamais tiré les conséquences de cette importante
découverte. Or, la fonte est un alliage de fer et de carbone contenant
environ 6 % de carbone ; c’est pour cela qu’elle est cassante. Le fer
doux, ou pur, est théoriquement exempt de carbone, ce qui explique sa
malléabilité. On passe de la fonte au fer doux par élimination
progressive du carbone contenu dans l’alliage spécial qu’est la fonte ;
au cours de cette opération de réduction du carbone, on passe par toutes
les concentrations intermédiaires de carbone dans le fer, correspondant
aux différentes variétés de fontes, puis d’acier : l’acier n’étant
lui-même qu’un alliage de fer et de carbone contenant moins de 0,85 % de
carbone" [45].
"Donc, qui
a fabriqué du fer doux est passé par l’acier ; tel était le cas des
Égyptiens des pyramides, tel est aussi le cas du forgeron de l’Afrique
noire. Il importe de distinguer deux types de forgerons :
a) Celui
qui produit la fonte à partir du haut fourneau et dont la tâche s’arrête
là ; il est le producteur du fer noir : wen bu nuul (en walaf)
[46]. C’est le forgeron métallurgiste.
b) Le
forgeron affineur qui, par un réchauffage et un martelage appropriés de
la fonte, réduit le carbone jusqu’au taux voulu correspondant au type
d’acier ou de fer désiré ; son travail équivaut à celui réalisé dans un
convertisseur Bessemer, où l’on réduit la fonte en acier. L’acier ne
sort donc jamais d’un haut fourneau, ce serait trop beau ; il est
l’œuvre du forgeron affineur.
"Ainsi,
compte tenu du processus de fabrication, il serait absurde de dire que
les Africains n’ont pas connu l’acier et qu’ils n’ont su fabriquer que
du fer doux ; qui peut le plus peut le moins ; celui qui a fabriqué du
fer doux aurait pu s’arrêter en cours de réduction pour obtenir de
l’acier ; s’il a fabriqué du fer "dur" ou de l’acier doux, c’est que les
usages domestiques l’exigeaient. La performance technique c’est donc
bien plus la fabrication du fer pur que celle de l’acier : aujourd’hui,
les spécialistes se perdent en conjectures devant les deux spécimens de
fer pur (d’époques plus récentes que le fer des pyramides) trouvés en
Inde et en Chine. Comment expliquer pour l’époque un tel pouvoir
réducteur qui donne du fer absolument pur ?
"A quelle
époque remonte cet Âge du fer en Afrique ?"
Les éléments
réunis semblent devoir conduire dans un très proche avenir à remettre en
question l’Âge du fer en Afrique noire.
La maîtrise
de la métallurgie du fer par les Égyptiens 2600 BC est attestée ; à
l’époque, ce fer ne pouvait pas provenir de l’Orient, l’Égypte n’ayant
pas de minerai de fer, celui-ci ne pouvait venir que de la Nubie et du
reste de l’Afrique Noire. Dès l’Ancien Empire, les Égyptiens avaient
l’habitude d’installer dans ces régions, en Nubie et au pays de Koush,
des factories pour traiter les matières premières extraites du sol sur
place. Ainsi fabriquait-on des meubles de luxe au cœur de l’Afrique
noire. Le même procédé a dû être employé pour le traitement du minerai
de fer à une époque très ancienne qui reste à déterminer. Ce n’est que
lorsque les recherches seront plus avancées que l’on saura, de l’Égypte
ou de l’Afrique intérieure, qui a influencé l’autre. Cela donne, à nos
yeux, un regain d’intérêt à quelques découvertes importantes, mais dont
l’interprétation a été escamotée (L epsius,
Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien, Dritte ABTEILUNG, BI 117)"
[47].
En ce qui concerne la Nubie, il faut distinguer la région
nord, entre la première et la quatrième cataracte, et la région située
au sud de la cinquième cataracte. Dans la revue Meroïtic Studies,
Meroïtica 6, S. 17-18, Berlin 1982, Peter L. Shinnie et François J.
Kense (Calgary) ont publié un important article intitulé : "Meroïtic
Iron Working", qui indique que des objets en fer datant de la 18e
dynastie (1580-1320 BC), existaient sporadiquement en Égypte :
"They are not necessarily proof that iron was being
smelted in Egypt and it may have come from western Asia in lingot form
and have been forged into objects of use or ritual in Egypt",
notent-ils, sans imaginer qu'il pourrait aussi venir du
Soudan central (Termit). En Nubie "a few iron objects were founds in
royal tombs from at least the time of Taharqa" (p. 20), c’est à dire
début 7 e
siècle BC
(région de Napata, en aval de la quatrième cataracte). A Méroé (entre la
cinquième et la sixième cataracte)
"The earliest fragment of slag from iron smelting was
found in a level which carbon 14 dates suggest is to be dated somewhere
in the late sixth century BC".
Mais la technique révélée par les vestiges des fourneaux
et soufflets est différente de celle qui était pratiquée en Égypte. Sauf
à trouver sur des sites non encore explorés, ou en profondeur, des
vestiges plus anciens de la métallurgie du fer en Nubie, dans l’état
actuel des recherches, Méroé ne peut plus être considérée comme un
centre possible de diffusion du fer à travers l’Afrique, puisqu’en
Afrique occidentale et en Afrique orientale interlacustre, la présence
du fer est attestée entre le
13e et le 15e
siècle BC, soit six à sept cents ans avant qu’elle ne le soit en Nubie,
sans même évoquer les sites de Nok, Ndalane et les dates les plus
anciennes du massif de Termit (3e
millénaire BC). En fait, chaque région a des types particuliers de
fourneaux et de soufflets (cf. annexe). Cependant, dans les
premiers siècles de notre ère, ceux de Méroé sont, selon R. F. Tylecote
(London), apparentés aux fourneaux romains [48]. Mais, lors d’une
récente soutenance de thèse consacrée à des fourneaux centrafricains, il
a été observé que les forgerons fondeurs modifiaient leurs fours et
leurs procédés selon les nécessités et les circonstances (qualité et
nature du minerai, usage auquel la matière à sortir du fourneau est
destinée…). Dans ces conditions, il paraît difficile d’établir une
typologie serrée des fourneaux. Parentés et différences changent alors
de signification. Les critères de classification sont de ce fait très
complexes.
Nous ne savons toujours pas où la métallurgie du fer a
débuté en Afrique. Mais sa technique a pu se répandre de proche en
proche, sans déplacement massif de peuples.
S. Lwanga-Lunyiigo (Ouganda), co-auteur du chapitre 6 du
vol. III de l’Histoire générale de l’Afrique (Unesco 1990),
expose son opinion en ces termes (pp. 186-187) :
"En appuyant mes conclusions sur
des preuves archéologiques, j’ai récemment émis l’hypothèse que les
populations de langues bantu occupaient depuis des temps très anciens
une large bande de territoire allant de la région des Grands Lacs
d’Afrique orientale au littoral atlantique du Zaïre, et que leur
prétendue migration depuis l’Afrique occidentale vers l’Afrique
centrale, orientale et méridionale n’avait jamais eu lieu.
Les faits connus indiquent que des peuples de type
physique négroïde occupaient l’Afrique subsaharienne depuis l’Âge de
pierre moyen et que les populations de langues bantu descendent de cette
souche négroïde. Il se peut que les langues bantu se soient développées
sous l’effet de l’interaction de diverses collectivités noires
primitives, se faisant des emprunts mutuels qui ont abouti à
l’apparition de nouvelles langues bantu à partir de ces amalgames
linguistiques variés. Cela n’élimine pas, assurément, le facteur
génétique tendant à démontrer l’origine unique des populations de
langues connexes, mais on doit souligner que le facteur génétique avancé
par les linguistes pour expliquer l’origine ou les origines des Bantu
n’est en aucune façon exclusif.
Les vestiges archéologiques témoignent de la présence en
Afrique subsaharienne de plusieurs zones d’établissements noirs
primitifs… En Afrique de l’Ouest, la preuve la plus ancienne de la
présence noire vient d’Iwo Eleru au Nigéria occidental, où a été exhumé
un crâne "proto-noir" remontant au début du 10e millénaire (–9250) avant
l’ère chrétienne...".
Je partage ce raisonnement. Il est d’ailleurs corroboré
par les considérations linguistiques de F. Van Noten et de Th. Obenga,
exposées ci-dessus.
En Zambie, le fer est présent au moins au début de l’ère
chrétienne. En Afrique du Sud (rive méridionale du Limpopo) la
métallurgie du fer est attestée au 3e siècle AD.
La présence même de cette industrie du fer qui se
développe, en Afrique subsaharienne, parallèlement à celle de la pierre
et des autres métaux (cuivre, or, étain, bronze,...) implique, notons-le
au passage, une population relativement nombreuse. Le commerce existait
déjà en Afrique noire à cette haute époque (cf. les expéditions du chef
de caravane égyptien Herkouf, déjà mentionnées à la fin de la IV e
dynastie, vers 2400 BC). De plus, "un certain nombre d’objets trouvés
en fouilles montrent que, dès l’Âge du fer ancien, il existait de vastes
réseaux d’échange" [49]. F. Van Noten observe que ce commerce
devait être "principalement limité" aux zones proches des grands
fleuves, car les sites éloignés des axes fluviaux ou de la région
interlacustre fournissent fort peu d’objets importés.
3. Conclusion
Depuis une trentaine d'années, plusieurs dates
particulièrement importantes ont été acquises qui permettent de préciser
très notablement l'ancienneté de la métallurgie du fer en Afrique noire.
Le point de nos connaissances sur le début de l'Âge du fer en Afrique se
présente comme suit :
1. Une métallurgie du
fer certaine entre le 13e et le 15e siècle BC
- d'une part dans la région du massif de
Termit (entre le lac Tchad et l'Aïr)
- d'autre part, à l'ouest du lac
Victoria-Nyanza et sur sa rive sud.
Cette métallurgie est donc très antérieure au
fer carthaginois, voire plus ancienne que le fer hittite ;
2. Des échantillons de
fer doux, non météorique, datent, en Égypte, de 2600 BC environ
(époque des pyramides), alors que l'on ne trouve pas de mines de
fer en Égypte ;
3. Une probabilité de
métallurgie du fer se situant entre 3000 et 2000 BC existe
a - dans la région du massif de Termit
(Niger)
b - dans la région de Kaolack (Ndalane) au
Sénégal
c - dans la région de Nok (Nigéria) ;
4. Une industrie du fer
est attestée à Taruga au 9e siècle BC (région de Nok) ;
5. Vers 700-600 BC, le
fer est également traité d'une part au Cameroun et au Gabon,
d'autre part dans la région du Nil moyen (Nubie). Il l'est aussi
près d'Agadès (bordure sud) à quelque 300 km à l'ouest du massif
de Termit. Des fouilles plus approfondies sont espérées dans ces
différents sites ;
6. Des réseaux
d'échanges étendus existaient au 3e millénaire BC
(rappelons sur ce point les quatre expéditions conduites par
l'Égyptien Herkouf au 24e siècle BC) — ce qui rend
possible un commerce du fer entre les différentes régions de
l'Afrique. Les modes de désignation du fer sont apparentés dans
les langues soudanaises et bantoues et en égyptien ancien. Le
fer a pu arriver en Égypte à partir du Soudan occidental et
central par l'Ennedi où une attestation ancienne de lances a été
remarquée par P. HUARD (cf. ci-dessus). On ne peut donc formuler
aucune conclusion sûre à cet égard actuellement. Seule la
multiplication des fouilles et des datations permettra d'en
savoir plus, quoique la vitesse de disparition du fer sous les
climats chauds et humides empêche probablement de découvrir
exactement ce qu'il en a été dans bien des cas. Cependant, les
vestiges de poteries associées, de fourneaux et de tuyères,
datables par la thermoluminescence, devraient fournir
prochainement une nouvelle moisson de dates significatives. Il
faudrait notamment dater les mines de Telenugar (Tchad) et
entreprendre des investigations dans la région du Fertit
(nord-est de la République Centrafricaine).
Puisse cette conclusion susciter des vocations, des
mécénats et l'organisation de nouvelles campagnes de fouilles.
Annexe :
Datation par le Carbone 14 (14C)
Deux phénomènes
principaux sont à la base de cette méthode qui est, de loin, la plus
utilisée :
1 -
Le Carbone 14 contenu dans l'atmosphère est absorbé par les organismes
vivants ;
2 -
Après leur mort, la radioactivité du Carbone 14 qu'ils ont fixé de leur
vivant, commence à décroître de façon régulière et mesurable.
La radioactivité du Carbone 14 diminue de
moitié en 5730 ans ± 40 ans. On dit que sa période de
demi-désintégration est de 5730 ans ± 40 ans. La limite utile des
mesures est habituellement de l'ordre de 40 000 ans mais atteint 60 000
ans si les installations sont très perfectionnées. Cependant, la
concentration en Carbone 14 dans les organismes, durant leur vie, a
varié avec l'intensité des rayons cosmiques. On observe donc des
irrégularités par rapport à la chronologie absolue, surtout entre 2500
et 1500 avant J.-C. D'où la nécessité d'utiliser la dendrochronologie
pour corriger les écarts et calibrer les dates obtenues par le
radiocarbone. Des tables de correction ont été établies, faciles à
utiliser. Elles ont été contrôlées et affinées grâce au magnétisme
thermorémanent et aux différences saisonnières dans les feuillets
sédimentaires (varves) déposés dans les lacs périglaciaires.
Le résultat des mesures est aussi affecté
par les fluctuations statistiques, comme dans toutes les mesures de
radioactivité, car les impulsions (ou désintégrations) émises par
l'échantillon sont distribuées au hasard du temps. Le résultat fourni
est donc une moyenne assortie des écarts évalués par des calculs
standardisés.
Conventionnellement, les dates sont d'abord
données "Before Present" (BP), c'est-à-dire avant
l'année 1950, prise au départ comme année de référence. Selon
le nombre obtenu, ces dates sont donc soit "Before Christ" (BC,
avant J.-C.), soit AD, anno domini,
c'est-à-dire des années du seigneur, autrement dit, de notre ère. Les
publications britanniques notent en lettres minuscules les dates non
corrigées : b.p., b.c., a.d., et réservent les majuscules pour
les dates corrigées. Mais les conventions internationales s'en tiennent
aux majuscules pour les dates non corrigées. Il faut alors utiliser les
tables de calibration 1, et savoir que les dates brutes, dites "conventionnelles",
sont basées sur l'ancienne estimation de la période de
demi-désintégration de Carbone 14 (demi-vie) : 5568 ± 30 ans, au lieu de
5730 ans ± 40 ans, de sorte que la date brute doit être multipliée par
1.03. Ces dates sont généralement publiées dans la revue Radiocarbon,
éditée par The American Journal of Science, (Yale University, New
Haven, Connecticut, USA). Mais certains laboratoires négligent
aujourd'hui d'envoyer leurs listes récentes, ce qui est regrettable.
Les dates concernant l'Afrique sont souvent
publiées par les inventeurs des échantillons et des chercheurs dans les
diverses revues consacrées à l'Afrique. Par convention internationale,
toute date radiocarbone brute est précédée du sigle servant à désigner
le laboratoire qui a effectué la datation, et ce sigle est suivi du n°
d'ordre, dans ce laboratoire, de la dite date, c'est-à-dire de
l'échantillon ; par exemple Gif- 5469, Dak-148.
Notes
1.
Ainsi que l'indique, par exemple, le récent ouvrage de T. SHAW, B.
SINCLAIR, B.W. ANDAH, A. OKPOPO, "Archaeology of Africa, Food, Metal
and Towns", dont le chapitre 17, rédigé par Augustin HOLL,
s'intitule "The Transition from Late Stone Age to Iron Age in the
Sudan-Sahelian Zone : a case study from the Peri-chadian Plain".
2 .
H. LHOTE, "La connaissance du fer en Afrique occidentale", in
Encyclopédie mensuelle d'Outre Mer, 25 septembre 1952, pp.
269-272.
3 .
Cf. L. M. DIOP, "Métallurgie traditionnelle et Age du fer en Afrique",
in Bulletin de l’IFAN, t. XXX, série B, 1968, n° 1, pp.
10-38.
4 .
et quelques
dixièmes, en fait (fouilles postérieures).
5 .
MAUNY, "Histoire de métaux en Afrique occidentale", in
Bulletin de l’IFAN, t. XIV, 1952, p. 578.
6 .
MAUNY, Encyclopédie d'Outremer, avril 1953, fasc. 32, p. 110 (fin
de l'article).
7 .
Mauny,
Bulletin de l'IFAN, t. XIV, 1952, p. 578.
8 .
Par exemple
Aoudaghost (en Mauritanie) sous l'empire de Ghana au 10e siècle ;
Teghazza gouvernée par le Mondzo (fonctionnaire songhaï) du temps de
l'Askia Mohammed, au 16e siècle.
9 .
Cités longuement par P. Huard, Bulletin de l’IFAN, juillet -
octobre 1964 (p. 376 en particulier).
10 .
Bulletin de l’IFAN, juillet - octobre 1964, série B, p. 297 à
397 : "Nouvelle contribution à l'étude du fer au Sahara et au Tchad".
11 .
Id., p. 371 : "parce que l'aire des sagaies, groupées dans
la même main s'étend jusqu'au Nil dans les temps modernes, d'autre part
parce que le dictionnaire touareg du P. de Foucauld contient le terme
eskekès pour désigner une petite javeline particulière aux Teda.
Il aurait fallu que l'introduction présumée de l'arme libyco-berbère ait
abouti à une transformation assez marquée pour appeler la création d'un
terme nouveau par ses initiateurs".
12 .
Id., p. 335.
13 .
Id. , p. 349 et 350.
14 .
Id., p. 356.
15 .
P. HUARD, op. cit., p. 390.
16 .
On sait que la civilisation yoruba présente des analogies, presque
des similitudes saisissantes, avec la civilisation égyptienne
pharaonique.
17 .
L.M. Diop, Bulletin de l’IFAN, t. XXX, B, 1968, n° 1, p. 31.
18 .
B. Davidson, op. cit., 1962, p. 146.
19 .
p. 386 du Bulletin de l’IFAN, juillet-octobre 1964.
20 .
A History of the Sudan from Earliest Times to 1821, by A. J.
Arkell, 1955, Londres, chap. III, p. 46.
21 .
Communication in Actes du Quatrième Congrès Panafricain de
Préhistoire et d'Étude du Quaternaire, section III, Tervuren,
Belgique, 1962, pp. 381-387.
22 .
L. M. Diop, "Métallurgie traditionnelle et âge du fer en Afrique",
in Bulletin de l’IFAN, tome XXX, série B, n°1, 1968, pp.
36-37.
23 .
J.M. Essomba, L’Archéologie au Cameroun, Karthala, 1992.
24 .
Communication de J. Devisse, p. 27. Voir aussi, 1993, Augustin Holl,
in The Archaeology of Africa, Food, Metals and Towns, T. Shaw, P.
Sinclair, B. Andah and A. Okpopo, ed. Routledge, London.
25 .
in Histoire Générale de l’Afrique, vol. 2, p. 676.
26 .
Revue d’Archéométrie, Université de Rennes : GMPCA, 1984, p.
112
27 .
W. Fagg, Merveilles de l’art nigérien, Paris, éditions du
Chêne, 1963, p. 13.
28 .
en 1976
29 .
C.A. Diop, "L’usage du fer en Afrique", in Notes
africaines, n° 152, IFAN, Dakar, octobre 1976, pp. 94-95.
30 .
Cf. Vallées du Niger, ouvrage collectif, Paris,
édition de la Réunion des Musées Nationaux, 1993, p. 73, 2e colonne et
p. 337, 1ère colonne, d’après Bernard Fagg, 1969, "Recent work in
West Africa : New light on the Nok culture", World Archaeology,
n° 1, pp. 41-50.
31 .
Cahiers de l’ORSTOM, vol. XI de la série sciences humaines,
n° 1, pp. 85-104.
32 .
Cf. C.A. Diop, Bulletin de l’IFAN, t. XXXIX, série B, n° 3,
1977, p. 466 et t. XXXXIII, 1981, n° 1 et 2, p. 11.
33 .
G. Quéchon, Communication au colloque de Maghnia (Algérie), "La fin
du néolithique et les débuts de la métallurgie dans le massif de Termit
(Niger)", à paraître, cité par M. Cornevin, 1993, et dans l'ouvrage
collectif Vallées du Niger, Musées Nationaux de France, 1993, p.
73. Ce colloque tenu en décembre 1988 et dont on attend la publication
des Actes, traitait de l’homme et de l’environnement depuis 100
000 ans en Afrique du Nord et au Sahara. Je remercie vivement G. Quéchon
d’avoir bien voulu me faire parvenir le texte de sa communication.
34 .
Histoire des villes d’Afrique noire des origines à la colonisation,
Albin Michel, 1993, p. 53.
35 .
Id., p. 61.
36 .
F. PARIS, A. PERSON, G. QUÉCHON, J. F. SALIÈGE, "Les débuts de la
métallurgie au Niger septentrional, Aïr, Azawagh, Ighazer, Termit",
in Journal des Africanistes, 62, 2 1992, pp. 55-68.
37 .
N. Echard, Mémoires de la Société des Africanistes, n°9,
1983, Paris.
38 .
A. Marliac, L’Age du fer au Cameroun septentrional, 1988, a
et b, Paris, ORSTOM, et thèse.
39 .
Cf. le tableau des mesures radiométriques effectuées.
40 .
"L’Age du fer ancien au Rwanda et au Burundi. Archéologie et
environnement", in Journal des Africanistes, 52, 1982,
p. 54.
41 .
Hist. Gén. de l’Afrique, Unesco, vol. 2, p. 689.
42 .
Id., p. 688.
43 .
L’Afrique dans l’Antiquité, Présence Africaine, 1973, p. 34.
44 .
C. A. Diop (1973), "La métallurgie du fer sous l'ancien Empire
égyptien", Bulletin de l’IFAN, tome XXXV, série B, n° 3, pp.
532-547.
45 .
C. A. Diop, Notes africaines, n° 152, octobre 1976, Dakar,
IFAN, pp. 93-95.
46 .
En égyptien ancien : bia kem = fer noir, "métal noir".
47 .
C. A. Diop, 1976, id.
48 .
"Metal Working at Meroe, Sudan", in Meroïtic Studies,
Meroitica 6, S. 29-42, Berlin 1982 et discussion pp. 43-49, spécialement
pp. 44 et 45.
49.
F. Van Noten, Histoire générale de l’Afrique, Paris, UNESCO, tome
2, p. 690. |

